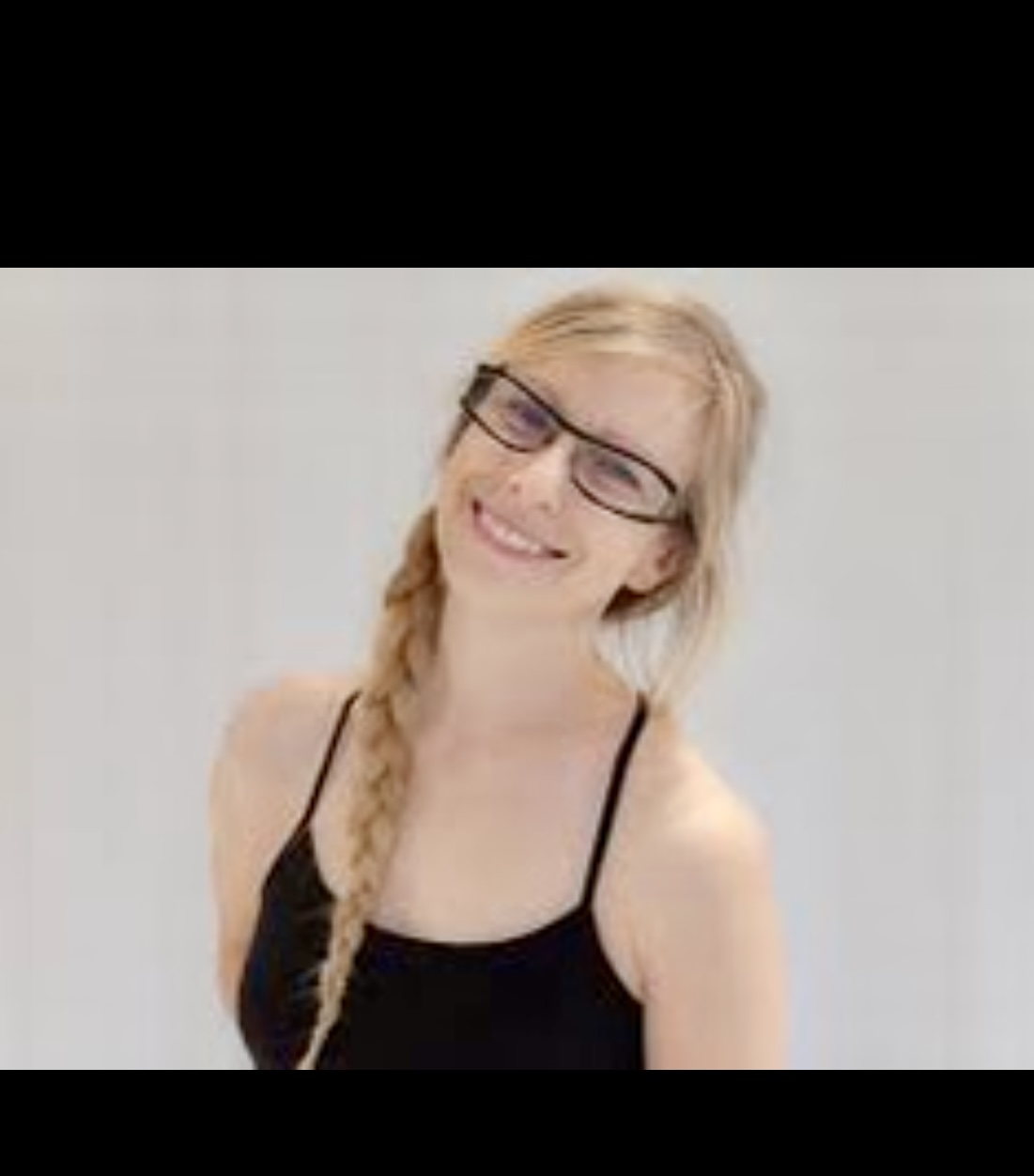Vous dire d’abord mon trouble. De retourner faire ce que j’ai fait sans discontinuer depuis l’âge de 20 ans, un sacré bail ! C’est-à-dire me retirer un moment de la vie réelle et trépidante du dehors pour m’enfermer dans une salle (plus ou moins) obscure et voir sans être vue. Voir quoi ? Un spectacle. Une représentation, une interprétation, une proposition, une mise en scène, une interrogation, une remise en question, un détournement du réel parfois, un remaniement du réel en tout cas, comme l’est toute œuvre fictive, la fiction étant toujours plus réelle en fin de compte que la réalité. M’enfermer dans une salle obscure (plus ou moins) pour repenser le monde.
Toute ma vie à faire ça puis écrire, parfois me mettre moi-même sur scène pour faire ça à partir de ma propre écriture… et puis plus rien ! La Covid, le confinement, la désertion des salles de spectacles (et de leurs annexes, les salles de restaurant, les salles d’embarquement, les salles de gym, les salles de visionnement, les salles d’accrochage… tous ces endroits où nous avions tant l’habitude d’être seuls, ensemble).
La foutue pandémie a arrêté cela. Mais une pandémie se pense-t-elle ? Un virus supra mortel (n’en déplaise à ceux qui n’y « croient » pas), le Sars-Cod-2 avec ses ventouses ultras efficaces peut-il, doit-il, être un objet d’interprétation, une matière à remanier le réel ? N’est-il pas le réel absolu, la biologie brute et brutale ? Et l’art est-il fait pour le penser, vraiment ? Pas tout de suite en tout cas, à mon avis. Car à l’opposé exact du journalisme, l’art doit prendre du recul, donc du temps. Pour répondre aux pourquoi, comment et surtout qu’est-ce qu’on a vécu, qu’est-ce que cette monstrueuse réalité nous a appris… il va falloir beaucoup de recul et beaucoup plus de temps.
L’art est-il fait pour traiter à chaud des grands mouvements mondiaux, pandémies, guerres, exterminations, mouvements politico-économiques et mutations sociétales ? Je ne pense pas. Le danger est de coller à la pensée commune, la pensée convenue, la pensée à la mode, la pensée politiquement et sociétalement correcte, la pensée multipliée, décalquée à l’infini, la pensée non libre, non originale bref, la non-pensée. Il y a toujours un risque majeur, oppressant, à s’engouffrer dans « ce dont il faut parler en ce moment » au risque de n’ouvrir que des portes déjà ouvertes. Oui, mais faut-il se taire alors ? Non pas ! Acquiescer, encore moins. Je n’ai pas la réponse. Je dis juste qu’art et actualité se marient souvent mal, on marche sur un fil périlleux.
Vous dire mon trouble alors, de retourner m’asseoir dans une salle pour regarder un spectacle de danse. Troublée j’étais parce qu’excitée comme si j’avais cru un moment que ce ne serait plus jamais possible, et troublée aussi parce que constatant que je m’en étais déshabituée, que peut-être ça ne me manquait pas tant que ça, que je ne pourrais peut-être plus écrire à propos, car peut-être que je n’aurais rien à en dire ou pire, qu’il n’y ait rien à en dire…
Finalement, j’ai choisi deux spectacles, de deux chorégraphes d’égale notoriété et qui cette fois-ci offraient leur regard respectif sur un sujet commun… Et c’est là que je ne parviens pas à nommer ce sujet. Leur sujet commun est-il LE féminin ? Ça ne veut rien dire. Le corps des femmes ? Archi rabâché. Les violences et les discriminations faites aux femmes et le silence qui leur est imposé ? C’est hélas ! multimillénaire. Le racisme et la xénophobie ? Oui sans doute, à désespérer Angela Davis d’avoir tant lutté (et lutter encore). J’ai choisi deux lieux et deux femmes chorégraphes dont j’aime depuis longtemps l’univers et que j’ai eu envie de retrouver, au fond d’une salle obscurcie, toute troublée que j’étais, et impatiente surtout, de voir comment chacune d’elle allait aborder le sujet qu’elles avaient choisi en commun. Quel sujet, donc ? Un fucking sujet : Être femme dans le monde d’aujourd’hui.
La Goddam Voie Lactée, de Mélanie Demers à l’Agora de la danse
Elles sont cinq sur la scène sur laquelle sont posés des tables et des pupitres. Elles portent des combinaisons semblables, rose orangé, pareilles, mais pas pareilles, toutes d’âge et d’origine différents, représentatives de l’humanité féminine. Ça commence dans des riffs de guitares électriques et un chant puissant et magnétique, celui de la musicienne et chanteuse Frannie Holder qui demeurera en scène tout du long aux côtés des quatre autres interprètes Stacey Désilier, Brianna Lombardo, Chi Long et Léa Noblet Di Ziranaldi. Cinq femmes magnifiques, puissantes, altières et affirmatives. Ça commence comme un concert, une cérémonie débridée, une messe because it’s a mess you see, un sacré foutoir de rébellion revendicative, mais un bordel significatif et signifiant.
À la Mélanie Demers en somme, femme de caractère et chorégraphe internationalement reconnue depuis longtemps maintenant, aux idées bien en place et à la capacité de révolte et d’affirmation déjà prouvée à maintes occasions, mais toujours renouvelée. Le mouvement, lui, est souple, fluide, chacune des interprètes sort de l’uniforme du début pour afficher son style, son physique, sa singularité, tant dans ses vêtements que dans sa gestuelle, et chacune dans ses propres mots. Et quels mots ! On connaît l’attachement de Mélanie Demers à l’expression verbale (et qui croit encore que les chorégraphes ne lisent pas, ne parlent pas, ne s’insurgent pas en actes comme en paroles ?) eh bien ici, la démonstration vaut rappel. Chacune dans son style, son langage, son accent, parfois franglais parfois français de Précieuse du 17e siècle parfois cri rauque et furieux, toujours la déflagration fait mouche. Danseuses, chanteuses, comédiennes, belles, magnétiques, dérangeantes, repoussantes, hurlantes ou touchantes, jamais indifférentes, et qui jamais ne laissent indifférent le spectateur.
Tout un sacré bordel alors, une saine colère, armées de séchoirs, de perceuses, d’un micro ou enveloppées de fausse fourrure et de miroitements, un beau foutoir minutieusement millimétré et ordonné, une tentative de rejoindre des étoiles qui brilleraient différemment. Quand les femmes montrent une nouvelle voie lactée, prière de cesser de regarder leurs ongles laqués !
Bon, évidemment, on voit bien l’influence du mouvement Me too et de ses ondes, mais en matière de création, c’est toujours le comment, comment sont présentées les idées, qui prime. La forme qui, comme le disait Victor Hugo, « est un fond qui remonte à la surface ». Ici, Mélanie Demers et ses splendides interprètes nous entraînent, dans un halo de fumée et de scintillements, vers un monde neuf, grinçant et optimiste, malgré tout. We are fucking awesome, clame l’une d’elles. Chiche !
When the ice melts, will we drink the water? de Daina Ashbee à l’Usine C
Sur une scène rectangulaire surélevée, une femme rousse, frêle et seule, belles chaussures fines à talon aux pieds, simple camisole sur le torse, simple culotte qui lui rentre dans le minou et le dessine. Elle fait le pont, soulève ses reins cambrés puis les plaque au sol, violemment, de plus en plus violemment. Molle puis soudain tendue, arquée, bras tendus dans un geste de défense, vain, regard embué perdu dans le vide de la salle qui autour d’elle ose à peine respirer devant cette cérémonie d’offrande, de sacrifice. C’est une femme offerte aux regards, offerte tout court. Une femme à la merci, offerte sans merci et sans en être remerciée. Lentement, entre tensions extrêmes et relâchements, tout le mouvement est concentré sur ses reins, ses hanches, elle ne quittera pas le sol, plaquée sur le dos. Lentement, elle amorce un mouvement circulaire, jambes ouvertes, exposant aux regards de tous son intimité sans protection, son entre-jambes précisément. Tout le drame du monde depuis toujours se joue dans l’entre-jambes des femmes. Pouvoir immense qui appelle à toutes les violences, les plus extrêmes. Fragilité absolue qui nécessite une infinie force de survie. Elle tourne sur son bassin, métronome du Temps. Du vivant. Vie et mort, Éros et Thanatos à jamais emmêlés dans cette blessure creusée au plus tendre et au plus intime. En cela tient tout le féminin, toute la condition féminine. Soulèvements du bassin, placages violents au sol dur, cercles lents, entrejambes ouvert, résistance, renoncement, résistance, tentative de protection, blessure. Résistante, rompue. Cassée, plaquée au sol dur sur le dos. Ça dure quarante-cinq minutes, une éternité. Cette histoire se répète sans fin depuis les siècles des siècles. Toutes les femmes la connaissent. Le malaise prend, non pas à la gorge, mais là, précisément là, dans l’entrejambe. Reconnaissance. Ça a bien dû m’arriver, au moins une fois, la peur, la force, le renoncement, la lutte, la souffrance, la honte. Et puis soudain le noir total, des cris et des hurlements, un rythme saccadé, précipité, qui s’accélère dans des gémissements de bête traquée, de biche forcée avant l’estocade finale, dans une musique à dresser les poils du pubis. Elle se relève dans la lumière qui revient. Serre les lèvres, replace ses cheveux. Remballe son pelvis, s’en va, même pas titubante. Jusqu’à la prochaine fois, le prochain assaut mortifère, un peu plus mortifère à chaque fois et inscrit dans ses chairs de toute éternité.
L’Usine C a eu la belle idée de proposer en octobre une rétrospective de la jeune chorégraphe hollandaise et métis Daina Ashbee qui a bouleversé la scène de la danse mondiale avec ses œuvres uniques à la puissance esthétique épurée et redoutable, la nudité exposée, mais jamais gratuitement, et son impact symbolique qui fouille la mémoire des violences faites aux femmes, aux peuples autochtones, aux dominés soumis aux dominants. Des pièces choc, coups de poing venus des chairs des interprètes, homme ou femme en solo, aux chairs des spectateurs. Cette fois-ci à l’Usine C, cette seconde œuvre sur les trois présentées, When the ice melts, will we drink the water, était interprétée par Angelica Morga sur une fulgurante musique interprétée live par Jean François Blouin. Inoubliable. Si on ne connait pas le travail de Daina Ashbee, il faut le découvrir.
On s’interroge sur le titre, qui est fait pour ça. Et quand les glaciers auront fondu, boirons-nous la tasse ? Et quand on aura détruit le féminin, qu’arrivera-t-il à l’humanité ? Irrémédiable.
Femme, ici et maintenant
Au final, Daina Ashbee et Mélanie Demers ont-elles vraiment traité le même sujet ? Euh… oui, mais non. Ou alors, oui, mais chacune à une extrémité du spectre.
Mélanie Demers propose avec cette œuvre un discours sociétal, collectif et revendicateur, un manifeste collectivement militant pour se débarrasser des vieux poncifs sur le féminin, ici et maintenant.
Daina Ashbee ne revendique rien, pas directement. Elle provoque des remous intérieurs, des fracas des plaques tectoniques intimes. Elle donne à vivre en soir le féminin meurtri, irrespecté, éternellement en danger. Qu’on soit homme ou femme, ça vous frappe là où ça fait mal.
Il reste qu’arrivée troublée, je suis ressortie de ces spectacles plus troublée encore, et il n’y a que ça qui compte. Aller s’enfermer dans une salle (presque obscure), quel plaisir renouvelé ! Je vais y retourner. Je vous le souhaite aussi.
www.agoradanse.com
https://usine-c.com/
www.dansedanse.ca