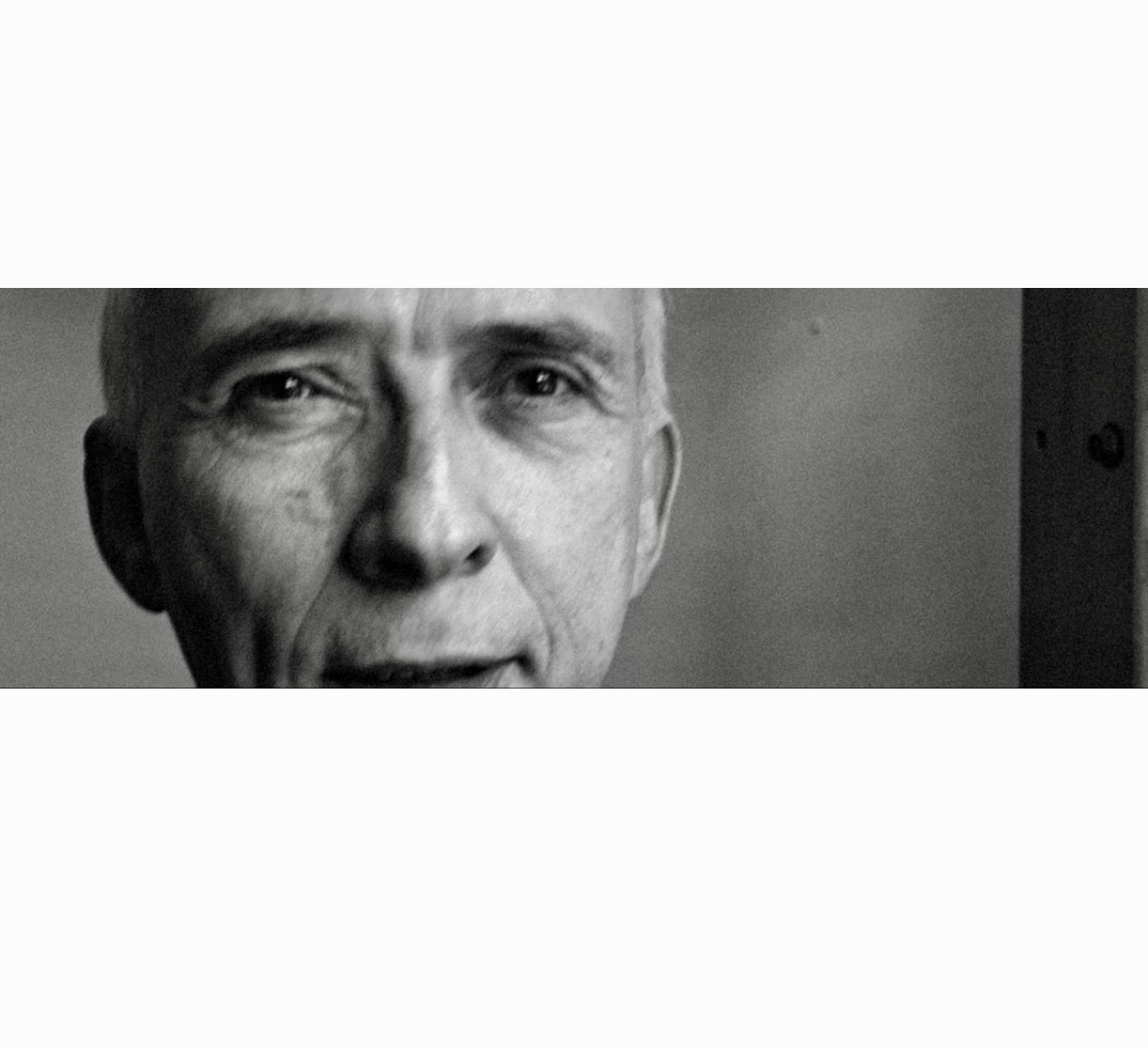Série Du beau monde. Snapshot 3 : Marina. Par Aline Apostolska.
À tire d’ailes, le moineau est entré dans la salle de restaurant. Sans la moindre hésitation, il s’est dirigé vers moi et s’est posé sur le côté gauche de mon assiette, sur la nappe blanche. De ses yeux globuleux d’un gris anthracite, il m’a fixée sans bouger. Assise en face de moi, Marina a tressailli puis a porté la main à sa bouche, comme pour étouffer toute forme de réaction.
Dans la salle, les convives étaient tournés vers nous, le moineau et moi, fondus dans ce dialogue aphone. Ni lui ni moi ne détournions le regard. Fala ti tato sto dojde da me vidis, ai-je dit après quelques longues minutes. Dobra sum, vidis, ne se sekiraj. Merci d’être venu papa, je vais bien tu vois, ne t’inquiète pas. Mozes da si odis sega, Do gledanjetato, do gledanje. Tu peux partir maintenant, Au revoir papa, au revoir. Pendant que je parlais, le moineau me fixait puis il est reparti, exactement comme il était venu, comme ça, par la porte principale de cette pizzeria que mon amie avait choisie sans savoir que mon père aimait y manger de temps à autre lorsqu’il séjournait dans la ville.
Je me suis lentement tournée vers Marina. J’ai vu ses yeux rougis de larmes et j’ai pu me mettre à pleurer, enfin. La veille nous avions enterré mon père dans la tombe de son père ainsi qu’il l’avait demandé. Depuis lors, une boule obstruait ma poitrine et m’empêchait de finir mes respirations. La boule venait de craquer, emportant les digues. Je tenais Marina par la main et nous pleurions. Ça prenait tout le mysticisme inséparable de l’orthodoxie orientale pour comprendre ce que nous venions de vivre, ou au moins de l’accepter comme tel. Pas forcément croyants mais mystiques, oui, tels sont les vieux peuples millénaires de la Méditerranée. Sur mes joues, les larmes coulaient, mais mon cœur s’était apaisé. Je me sentais un petit moins coupable de n’être pas arrivée à temps pour embrasser mon père une dernière fois avant sa mort, moi l’éternelle absente. Je tenais la main de Marina et c’est tout. Je n’avais rien à expliquer. À Marina, je n’ai besoin de rien expliquer. Elle sait. Depuis toujours, Marina est celle qui me sait.
Pensez-y bien : combien de personnes vous connaissent-elles depuis votre naissance ? Je veux dire combien de personnes – en-dehors de vos parents, si toutefois vous avez la chance qu’ils soient encore en vie? Poussons la question plus loin : avec combien de personnes qui vous connaissent depuis votre naissance êtes-vous encore en lien profond, pas seulement en lien, mais en lien étroit ? Poussons la question encore plus loin : avec combien de personnes qui vous connaissent depuis votre naissance demeurez-vous en lien étroit malgré l’éloignement et l’absence ? Malgré le fait que votre vie commune soit surtout tissée de lointains et d’ailleurs ? Est-ce que dans votre vie cette personne-là existe ? Dans ma vie à moi, cette personne existe. Elle s’appelle Marina. Faut-il pleurer de l’avoir si peu vue, ou bien se réjouir qu’elle soit toujours là, qu’elle fasse mentir l’adage loin des yeux loin du cœur ? Il y a des jours avec et des jours sans. Des jours avec des sourires et des jours avec des larmes. Tout ce qui touche à mes origines s’avère clair-obscur, et plutôt obscur que clair, mais Marina, elle, brille dans la clarté de mon cœur depuis plus de six décennies. Il a dû être content, mon père, et rassuré, de nous voir ensemble, ainsi attablées dans cet agréable restaurant du centre-ville de Skopje, comme si de rien n’était.
Tous, nous sommes si occupés à faire et à réussir ce que nous faisons. Tant préoccupés par tant de faires qui masquent l’être, le faire finissant trop souvent par prendre le dessus sur l’être, parce que c’est si facile de faire pour oublier de se poser des questions. Faire : changer l’être de place, comme on dit changer le mal de place. Et puis adviennent ces moments cruciaux où l’être réapparait. Cela advient lors de deuils. Le chagrin est la revanche de l’être sur le faire. Le chagrin apporte des épiphanies. Avec une impitoyable nudité, nous regardons alors notre vie qui dans pareils moments semble avoir été vécue pour rien. Oui, pourquoi faire, finalement ?
En ce début d’août 2018, dans ma ville de naissance de Skopje, capitale de la Macédoine du Nord où j’étais revenue, après vingt ans d’absence, pour enterrer mon père, j’avais la chance improbable que Marina me tienne la main quand même, et me tenant simplement la main, partage mon chagrin.

Commençons donc par le début.
Fin 1961. Ma mère part rejoindre mon père à Paris. Ma grand-mère, abasourdie d’apprendre qu’elle a une petite-fille, me recueille. Elle a déjà une filleule, prénommée Marina. Née un an et demi avant moi, en décembre 1959, et dont les parents habitent l’immeuble en face, dans cette cité si typiquement communiste nommée Prolet, le printemps. Une caricature de ces noms communistes qui devaient évoquer l’éveil, le renouveau, la gloire et le triomphe du peuple…bien que ma famille paternelle ne fasse pas exactement partie du peuple, mais plutôt des ex-seigneurs terriens devenus des dirigeants politiques, ou des dirigeants des sphères de production prolétarienne, à l’image de mon grand-père paternel, directeur du conglomérat de tabac qui fournit Kent et Camel (aujourd’hui racheté par Philip Morris). Tous les habitants de la cité de Prolet se sont vus attribuer un appartement par leur entreprise. C’est le cas de mon grand-père, mais également du père de Marina. Sa mère travaille aussi, alors ma grand-mère, qui n’a jamais travaillé à l’extérieur, garde sa filleule. Lorsque je débarque dans sa vie, ma grand-mère a 48 ans. Elle nous met ensemble dans le même berceau. Marina devient ainsi ma sœur de lait. Du lait de vache avec du miel que ma grand-mère aimait à nous faire boire, à moi l’agitée, malingre, hurlante, souvent malade, des otites à répétition, et à Marina la sage, rondouillarde, jamais malade, de grands yeux doux et le sourire toujours sur les lèvres. Nous avons grandi telles quelles. Trois ans plus tard, je quitterai définitivement la Macédoine pour rejoindre mes parents à Paris. La France deviendra mon pays. Je ne verrai plus guère Marina et ma grand-mère que durant les vacances d’été. Mais le lien, avec l’une comme avec l’autre, perdurera, absolu, propédeutique. Lorsque j’ai eu 24 ans, ma grand-mère est décédée et très peu de temps après, la mère de Marina. Cancers fulgurants, toutes les deux. Depuis lors, Marina est la seule à se souvenir de l’enfant que j’étais dans les toutes premières années de ma vie.
Marina serre ma main et me dit : « Tu te souviens, ce que tu faisais ? Personne ne va te battre, me disais-tu, et puis tu envoyais des coups de poing partout alentour les yeux fermés. Et c’est vrai, tu faisais fuir les garnements.» Nous rions. C’est vrai, j’étais comme ça à trois ans, tandis qu’elle fermait les yeux en attendant que les autres la tapent. Pourquoi ? «Tu te souviens pas, me dit Marina. On avait un tas de méchants voisins. » Oui, c’est vrai, et je les battais, poings serrés, yeux fermés, pour nous protéger. Nous avons grandi, Marina a appris à se défendre. À de nombreuses occasions, c’est elle qui m’a défendue. Elle, toujours raisonnable, et moi, toujours infernale. Comme le côté pile et le côté face d’une même pièce. Bien sûr que je me souviens, Marina, je me souviens de tout.
Marina a dix ans, moi huit. Nous jouons à cache-cache avec les autres enfants de la cité Prolet, nous n’avons pas que de méchants voisins. Mon amie me rappelle toujours à l’ordre, me pousse toujours à rentrer parce que la nuit est tombée, que ma grand-mère nous attend sur le balcon, dévorée par les moustiques qui s’en donnent à cœur joie après qu’elle a arrosé les rosiers devant son balcon.
Marina a dix ans, comme tous les étés, on se retrouve à Skopje à la fin juin quand nos écoles respectives finissent et que deux longs mois d’été nous ouvrent les bras. Tout au long de l’année, nous échangeons des lettres. Mon cœur se dilate toujours lorsque j’aperçois sa belle écriture appliquée sur l’enveloppe bleue. Où ai-je mis ces lettres ? Dans ma malle rouge restée en France chez mon amie Dominique, je crois… «Qu’aurais-tu pu faire sinon devenir écrivaine ?» m’a déjà dit Marina. C’est vrai bien sûr. Écrire m’a permis de rapiécer un peu, bon an mal an, les tissus épars de ma vie.
Excellente élève, à dix ans, Marina porte un foulard rouge et un chapeau orné d’une étoile rouge à cinq branches, uniforme des jeunes pionniers de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. À l’école, elle scande des chants patriotes et apprend la théorie marxiste, elle me dit qu’elle veut être communiste, qu’elle veut participer à construire un nouveau monde. Elle fait partie de cette génération qui a cru si fort en la Yougoslavie. Mon grand-père, mes oncles, tout comme son père à elle, se sont battus pour cet idéal. Pas mon père, non, lui il n’y croyait pas justement, et dès la fin des années 50, il a choisi la France, pour lui-même et ses descendants. J’adore la télévision yougoslave. Les programmes commencent par l’hymne national et l’on écoute les longs discours de Tito que ma grand-mère vénère d’autant plus qu’il est croate, comme elle. Faut bien dire qu’il est beau, très élégant et qu’il parle très bien. À la télévision yougoslave, tout est jovial. À cette époque, les peuples slaves du sud sont tous joyeusement mélangés, complices et unis, Croates, Serbes, Monténégrins, Slovènes, Bosniaques, Herzégovines, Albanais et mêmeTziganes (la Yougoslavie est le seul pays au monde à avoir accordé une nationalité aux peuples apatrides roms et tziganes), chacun avec sa langue, sa religion, son histoire, ses différences socio-économiques, son écriture, tout est un magnifique et fructueux mélange, dans un parfait respect mutuel. On les voit tournoyer main dans la main dans des rondes folkloriques, et chanter à pleins poumons leurs chants séculaires. Je n’y comprends rien, mais quelle importance, tous semblent libres et heureux, ça donne envie de danser avec eux.
Quand j’y vais l’été, j’ai l’impression qu’ils vivent dans un monde idéal, alors qu’eux pensent de moi que je vis à Paris comme à Disneyland entre Peter Pan et la fée clochette. La vérité est tout autre : je vis en effet dans les beaux quartiers parisiens au cœur du capitalisme triomphant des années soixante, mais ma vie est schizophrène : dix mois d’une vie et d’une éducation strictement française, voire Vieille France, et deux mois en Yougoslavie, enfin libre de mes parents et leur vie folle saturée de violences conjugales. Aller retrouver chaque été ma grand-mère et Marina me permet de souffler et de réparer mes forces.
Je ne prononce pas un seul mot de macédonien durant toute l’année (je n’ai jamais parlé qu’en français avec mes parents), alors l’été, la première semaine, je fais des erreurs, et puis ça revient, je retrouve momentanément ma langue dite maternelle. Marina se moque de moi, je ne sais pas lire le cyrillique, alors elle part en croisade, elle me donne des cours, je dois savoir lire le macédonien, comment ça, je ne peux pas ne pas savoir ! Elle a raison. S’il n’avait été que de mes parents, je n’aurai jamais rien appris, ni de la langue, ni de l’écriture, ni de l’histoire de mes ancêtres. Mais lorsqu’en septembre, je retourne à Paris, la première semaine j’ai aussi du mal, les mots de français m’échappent, et puis ils reviennent. Jusqu’au jour où tout cela s’équilibre. Quel extraordinaire mystère que celui de la mémoire des langues !
Marina a seize ans, elle apprend le français depuis plusieurs années au collège. C’est la langue seconde qu’elle a choisie. En ce mois de juin 1976, c’est elle qui vient me rendre visite à Paris. En pleine canicule historique. Je la promène partout, je lui montre tout. Nous traversons Paris du matin au soir, de semaine en semaine, à pied, puis nous allons à Versailles, au château, passage obligé. Pour nous rafraîchir, je lui propose d’aller nous tremper les pieds dans le cours d’eau qui longe le Hameau de Marie-Antoinette. C’est interdit, mais je franchis la barrière et elle me suit. Le gardien nous voit et fonce vers nous, furibond. « Marina, lui dis-je précipitamment, parle-lui, dis-lui je ne comprends pas le français, vas-y dis-lui avec ton accent, comme ça ils nous prendra pour des touristes ignorantes. Moi je vais me taire.» Le stratagème fonctionne si bien que le gardien nous laisse là, à nous rafraîchir les pieds dans le ruisseau de Marie-Antoinette. La veille, nous nous étions baignées dans les bassins du Trocadéro devant la Tour Eiffel, bon.
Petite déjà, elle voulait voyager partout, Marina, et elle l’a fait. Elle a sillonné l’Europe en autobus, en train, en avion. Elle est allée jusqu’en Russie qui était alors l’Union soviétique. En bonne gestionnaire économe, elle a toujours su prioriser son budget voyage. Elle lit, elle découvre, elle se prépare et puis elle part. «Tu t’assieds dans un véhicule, me dit-elle avec des étoiles plein ses grands yeux noirs en amande, et voilà, tu es partie !» Son premier gros achat a été de s’acheter une voiture, une Fiat 500 blanche qu’elle était si fière de conduire, à un âge où je n’avais même pas encore passé mon permis. Communiste, féministe, indépendante, entreprenante, déterminée, travaillante, pragmatique, oui. Et humaniste. Pharmacienne diplômée. Une femme remarquable. Je l’idéalise ? Ben oui, forcément, mais à vrai dire, pas tant que ça.
Marina a vingt–neuf ans. Elle passe ses vacances avec moi chez ma mère, sur l’île de Hvar en Croatie. Nous sommes nues sur les longues pierres plates qui avancent entre le bleu et le bleu, celui du ciel et celui de la mer Adriatique. «Je suis enceinte» lui dis-je et le cri qu’elle pousse interrompt le zézaiement des cigales. Elle est ravie et intriguée : «Je pourrais avoir un enfant, moi aussi » me dit-elle. Ni elle ni moi ne sommes mariées et n’envisageons pas de l’être. Mon fils naît en avril 1988, le sien en août 1990. Un type formidable son fils, qui joue au foot, parle des langues, travaille pour une ONG, sillonne la planète. Létonie, Estonie, Pologne, Espagne, Portugal, France, Grèce, Finlande, Aruba, République Tchèque etc etc… et Marina, en mère fière et épatée, le rejoint de temps à autre, ici ou là.

Lorsqu’elle est devenue mère, elle n’avait plus que son père. Sa mère était morte lorsqu’elle avait vingt-cinq ans. Quelques mois après que ma grand-mère est morte. Cancers fulgurants, emportées en quelques semaines, sans crier gare. Nous nous sentons orphelines. Quand elle devient mère, l’absence pèse plus lourd. J’ai ressenti la même chose. Nous en pleurons ensemble, et continuons à nous écrire et à nous soutenir, si loin, si près.
La naissance de son fils occulte un peu la catastrophe de la dislocation de la Yougoslavie. La Macédoine devient un pays indépendant en 1991 après référendum auprès de ses quelque deux millions d’habitants. Marina est bien occupée avec son nourrisson. Elle a voté oui, néanmoins son cœur est brisé. Les atrocités dont les récits lui parviennent chaque jour la terrassent même si, en 1991, on n’a encore rien vu. Bientôt ce sera le drame de la Bosnie, de la Croatie, puis du Kosovo. Marina est en colère, très très en colère. C’est comme si le soleil s’était obscurci. « Sombres connards, dit-elle, et maintenant quoi ? On va vivre entre nous, entre petits Macédoniens, comme au temps du Sultan ! Quelle régression ! Quelle catastrophe ! » Je la comprends. Tout comme elle, je ne comprends pas la grégarité du nationalisme.
Le bon aspect de la chose, c’est que le nouveau gouvernement macédonien offre aux habitants de racheter les appartements que l’État yougoslave leur avait attribués sans qu’ils en soient pour autant propriétaires. Le père de Marina achète donc l’appartement dans lequel la famille vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la cité de Prolet. Tous font ça d’ailleurs, y compris mon père qui rachète l’appartement de ses parents. Le père de Marina se remarie d’ailleurs et lorsque sa seconde épouse meurt, il se retrouve également propriétaire de l’appartement qu’ils occupaient ensemble. À la mort de son père, Marina hérite. Elle laisse leur maison de campagne à sa sœur, garde l’appartement de Prolet pour elle et donne le second à son fils. Lorsque je vais à Skopje, je vais dans l’appartement de ma grand-mère situé en face de l’appartement de Marina. Malgré tous les changements, rien n’a changé.
Par-delà les va, les vient, les absences, les éloignements, les drames, les deuils, les langues, les divorces, les mariages, les naissances, les guerres et les morts, depuis 75 ans, ces deux appartements de la cité de Prolet se font face et Marina et moi nous faisons signe au réveil par la fenêtre. Quand nous étions enfants, c’était un signe pour aller jouer dehors, aujourd’hui c’est un signe pour se retrouver chez moi et chez elle pour prendre un bon café. Un café turc. Avec une cuillérée de confiture de pastèque (la recette de ma grand-mère) ou de confiture de raisin blanc (la recette de sa mère).
Tiens-moi la main, Marina. Nous irons marcher dans la vieille ville turque au bord du Vardar le long duquel se dressent des centaines de statues de tous les grands héros macédoniens, dont le plus grand de tous, Le Grand, Alexandre, qui surplombe la ville sur son fier destrier (dont on sait qu’il était noir). Nous mangerons des burek, des cevapcici, des pastermarliji, des geverci, boirons de la rakija et de la boza, nous régalerons des loukoums, des sampiti et des tulumbi dégoulinantes de sirop de sucre.
Nous roulerons jusqu’au divin lac d’Ohrid, les arènes intactes du 2e siècle, la via Egnatia que les Romains construisirent pour traverser de l’Adriatique à l’Égée et que l’on rejoint à côté d’Ohrid, à Radozda, les grottes des anachorètes du 12e siècle, les lieux mystiques orthodoxes creusés à même la pierre, tout là-haut en à–pic, le monastère de Saint-Naum du 11e siècle, l’église Saint-Georges de Kurbinovo avec les fresques de Cyrille et Méthode du 13e siècle… Le lac de Prespa, le plus vieux lac d’Europe, source archéologique du peuple macédonien. Les innombrables montagnes de Macédoine qui sont le sanctuaire du lynx, emblème du pays. L’été, les guirlandes de tabac qui sèchent au vent répandent leur parfum enivrant par-dessus le treillis des vignes, les champs de tomates, de piments, de pastèques, les vergers de figuiers et d’abricotiers. L’hiver, la neige obstrue les canyons, barre le passage et gèle les lacs. Alors la Macédoine, berceau de culture occidentale, redevient le royaume des loups, des ours, des sangliers, des hordes de chevaux sauvages.
Tiens, c’est l’anniversaire de Marina bientôt, début décembre, je me souviens. Je vais l’inviter à venir ici, on pourrait faire un beau tour aussi, c’est pas les kilomètres qui manquent.