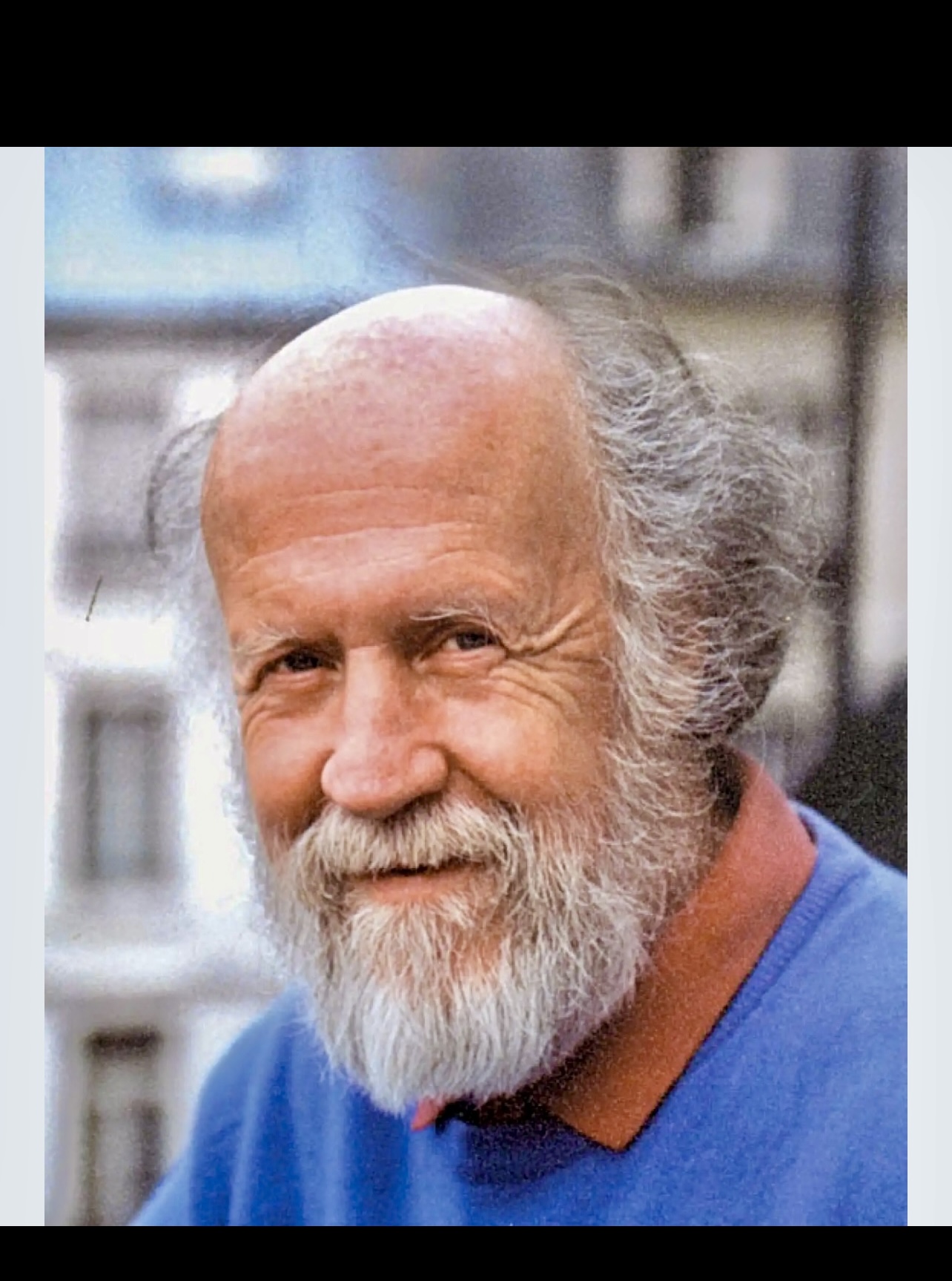Entretien avec la réalisatrice marocaine, Maryam Touzani, (Ali’n productions, Casablanca, le 24 août 2023). Par Laurent Beurdeley
À Marc André Lussier, maestro de la critique cinématographique au quotidien La presse (Montréal) qui s’est éteint subitement le 3 juillet 2023. Ses articles d’une grande finesse d’analyse étaient et demeureront une référence incontournable pour tous les cinéphiles.
Remerciements à Fathi Lamfaddal et à Jean-Rémi Descoutrioux (Ali’n productions) qui ont facilité cette entrevue et à Maryam Touzani pour son charmant accueil, sa généreuse disponibilité, sa profonde sincérité et authenticité.
Vous êtes née à Tanger, une ville auquel vous êtes très attachée. De nombreux réalisateurs y ont posé leurs caméras pour le tournage de quelques scènes. Selon vous, quels sont les cinéastes qui ont le mieux mis en valeur la perle du Détroit : Bertolucci : « Un thé au Sahara » (1990 ) ; André Téchiné : « Loin » (2001) ; « Les temps qui changent » (2004) ; Jim Jarmusch : « Only Lowers alive » (2013) ou d’autres encore ?
C’est une question difficile. Tanger est une ville que j’aime profondément, j’y suis revenue après mes études à Londres. Quand j’ai commencé à comprendre ce que représentait Tanger dans l’imaginaire collectif, j’ai commencé à la voir différemment, je cherchais un autre Tanger dans ce Tanger-là. Je me suis rendu compte en quittant la ville de ce que Tanger était et représentait, du mythe de Tanger, de ce Tanger international (un territoire autonome entre 1924 et 1956) dont j’ignorais tout. Mais je n’ai jamais vu cette ville-là avec des yeux de cinéaste. C’est avant tout la ville de mon enfance, de mes souvenirs de famille.
L’expérience culturelle que représente Tanger m’a marqué en grandissant avec ma grand-mère qui était espagnole. Sa famille s’est installée à Tanger lorsqu’elle était encore une enfant, elle y a rencontré mon grand-père marocain musulman. C’est d’ailleurs une histoire très romanesque qui fait partie de ce désir de comprendre cet autre Tanger que je ne connaissais pas. Mon premier court métrage, « Quand ils dorment », a été tourné à Tanger. C’est le seul film que j’ai tourné dans cette ville et j’ai vraiment envie d’y réaliser un long métrage. Je ne saurais pas vraiment vous dire qui a mis le mieux en valeur Tanger. Je ne me suis jamais posé cette question en fait. Il faudrait peut-être que je me la pose maintenant.
Que pensez-vous de tous ces intellectuels, artistes (notamment ceux de la Beat Génération) qui fréquentaient Tanger pour fuir l’Amérique puritaine et s’encanailler (paradis artificiel, sexe tarifé, homosexualité ….) mais fréquentaient, semble-t-il, assez peu les autochtones pratiquant plutôt un entre soi.
Je ne sais pas si c’était juste un entre soi. C’est vrai qu’ils venaient chercher à Tanger ce qu’ils n’arrivaient pas à trouver ailleurs, c’est-à-dire cette liberté, ce sentiment d’être libéré de toutes les contraintes sociales. Je ne sais pas s’ils ne fréquentaient pas les autochtones. Je ne suis pas sûre de ça. C’est vrai qu’ils étaient beaucoup entre eux. Mais je pense que c’était beaucoup plus perméable, plus poreux que l’on imagine. Paul Bowles (et son épouse Jane), par exemple sont demeurés longtemps à Tanger et ils eurent beaucoup d’amitié et des relations durables avec les Tangérois. C’est différent pour les autres écrivains de la Beat Génération qui ne sont pas restés autant qu’eux sur place. La majorité d’entre eux était seulement de passage, comme Jack Kerouac ou encore Allen Ginsberg …. Il y a aussi ceux qui sont revenus plus tard à la recherche de ce Tanger mythique qui n’existait plus réellement et qu’ils ont tenté de recréer et là pour le coup c’était plus entre eux, c’est plus l’impression que j’ai.
Avez-vous encore le souvenir du premier film visionné en salle à Tanger lorsque vous étiez enfant ou adolescente ?
J’ai une mémoire essentiellement émotionnelle, je ne retiens pas de titre. Le premier film marocain que j’ai vu : « Ali Zaoua prince de la rue » (de Nabyl Ayouch) fut d’ailleurs ma première claque de cinéma ; je l’avais découvert lorsque je faisais mes études et je n’avais aucunement retenu le nom du réalisateur. Ce n’est que plusieurs années plus tard lorsque j’étais journaliste et que je préparais une entrevue avec Nabyl Ayouch que je me suis rendu compte qu’il avait réalisé ce long métrage. J’allais très peu au cinéma lorsque j’étais adolescente à Tanger. La plupart des salles obscures de la ville projetaient des films indiens, égyptiens, seulement quelques films marocains ; ce n’était pas un cinéma qui me parlait vraiment.
Comment dirigez-vous les acteurs ? Poussez-vous les comédiens dans leurs retranchements ?
Je suis une personne extrêmement exigeante envers moi-même et je suis très exigeante avec les acteurs. Je les pousse dans leurs retranchements quand il le faut, lorsqu’il y a quelque chose qu’ils ne vont pas chercher en eux ; je ne lâche rien. Je peux refaire de multiples prises jusqu’à ce que j’obtienne ce que je veux.
Faites-vous beaucoup de répétition avec vos acteurs ? Peuvent-ils faire évoluer le scénario ?
Je ne répète pas, car je n’aime pas que les comédiens soient dans un jeu, je privilégie la spontanéité. Je vais répéter ce qui est technique, je ne fais jamais répéter l’émotion, jamais ! Par contre avant chaque scène, je fais le point avec les comédiens. Selon moi, il est indispensable que l’on soit au bon endroit émotionnellement. J’essaie pour cela de tourner la plupart du temps dans la chronologie de l’émotion et dans la chronologie tout court, lorsque cela est possible (ce qui est presque toujours le cas). Je suis presque toujours parvenue à être dans une chronologie assez logique et je trouve que cela est respectueux des comédiens, de leur évolution. C’est primordial, tous mes films sont des films de l’intime, l’évolution émotive des personnages s’avère importante et j’ai envie de donner aux interprètes le maximum de possibilité d’évoluer dans leur personnage et d’éviter les allers et retours émotionnels.
Avec les acteurs, j’évoque beaucoup la psychologie des personnages. Il est fondamental qu’ils puissent bien saisir le personnage que j’ai envie de raconter et ce que je désire aller chercher chez ce personnage-là et que l’on puisse le faire ensemble. Il faut qu’ils puissent être dans cette recherche de vérité des personnages qu’ils incarnent. Cela implique une compréhension de leur environnement, ainsi dans « Le Bleu du Caftan », Saleh Bakri et Ayoub Missioui qui campent respectivement Halim et Youssef ont passé beaucoup de temps avec un mâalem (un maître-artisan). Je tenais tout particulièrement à ce qu’ils sachent comment tenir une aiguille, qu’ils connaissent précisément les différents tissus ; ce fut pour eux une immersion dans le réel.
Avec les interprètes, laissez-vous de la place à l’improvisation ?
Très peu, après je suis à l’écoute et si on me propose des choses qui me parlent …Je ne suis pas hermétique à ça.
Dans quel environnement écrivez-vous ? Plutôt à votre domicile ou dans un autre lieu spécifique ? Écoutez-vous de la musique pendant le processus d’écriture ?
Quand j’écris, je suis en transe. J’écris à la maison. Et je peux aussi écrire n’importe où. Pour « Adam », j’étais enceinte, l’écriture est née en sentant mon bébé qui commençait à gigoter à l’intérieur de moi. Nous étions à ce moment-là à Paris avec Nabyl, il travaillait sur la postproduction de « Razzia ». Mes idées venaient en marchant puis je retranscrivais mes pensées en me posant Place des Vosges. Ensuite, j’ai repris à la maison à Casablanca. J’écris dans le silence et comme j’aime la lumière, le soleil, j’écris de jour et jamais la nuit. Je m’enferme avec mes personnages en me laissant porter et m’oublier en fait. Je ne sais pas où je vais, j’écris séquence après séquence. C’est immersif et émotionnellement très prenant. J’ai l’impression de vivre émotionnellement avec mes personnages. C’est quelque chose de viscéral que je ne rationalise pas. Mais l’écriture a toujours été pour moi un exutoire, j’ai toujours écrit de la poésie depuis que j’étais très jeune et je n’ai rien voulu publier. Le journalisme rejoignait pour moi mon besoin d’expression. Ce que j’aime particulièrement c’est écouter les autres et donner chair à leurs histoires. La rencontre humaine, c’est quelque chose qui me passionne.
Vous collaborez étroitement aux scénarios de Nabyl Ayouch (« Much Loved », « Razzia », « Haut et Fort ») et ce dernier contribue également d’une certaine façon à l’écriture de vos films. Comment se répartit précisément le travail d’écriture entre vous ?
Pour « Much Loved », c’est Nabyl qui a rédigé le scénario, par contre j’étais là dès la naissance de ce désir et j’étais également présente à ses côtés pendant toutes les rencontres qu’il a effectuées avec les prostituées, soit près de 200 (j’en ai également interviewé quelques-unes). C’était un travail très approfondi sur le terrain. Afin de rechercher des vérités, Nabyl a toujours cette démarche presque anthropologique quand il fait un film. J’ai suivi l’écriture et avec « Much Loved », c’est très particulier dans la mesure où c’est un scénario qui fut écrit d’une manière assez libre, les scènes sont écrites, mais il y a une marge de liberté. Le premier scénario véritablement coécrit fut « Razzia » et ce n’était absolument pas prévu (on ne s’est jamais dit que l’on allait écrire un film ensemble). Nous avons discuté tous les deux des personnages et de son histoire et, petit à petit, on s’est retrouvé à écrire ensemble sans vraiment le décider. On échangeait des notes à lire. Pour les autres films, c’est différent, chacun écrit son scénario et en même temps on collabore d’une certaine façon à l’écriture l’un de l’autre, surtout par l’échange et l’écoute.
Je ne suis pas quelqu’un qui aime partager lorsque j’écris, je n’aime d’ailleurs pas les workshops d’écriture avec l’intervention de personnes différentes. L’écriture est pour moi quelque chose de très intime, je ne peux pas m’ouvrir et demander par exemple : « Que pensez-vous de ça ? ». Il y a dans mon écriture quelque chose de très irrationnel. Dans notre collaboration avec Nabyl, on se connaît tellement bien qu’il y a des choses que l’on n’a pas besoin de se dire. Quand j’écris, je le donne à Nabyl et je sais que j’ai un retour bienveillant avec la sensibilité que je cherche dans le regard ; nous nous complétons. C’est un retour vrai qui contribue à me pousser dans mes retranchements et qui me met face à des choses que je ne vois pas forcément ; de son côté, c’est pareil. Entre nous, c’est toujours dénué de tout ego. C’est très rare de trouver ça chez l’autre. C’est un peu comme écrire seul et en même temps avoir un miroir. C’est écrire seul, mais être accompagné. J’aime la solitude, mais j’aime être accompagnée. C’est comme deux solitudes qui arrivent à se retrouver sans jamais exercer de pression l’une sur l’autre en aidant l’autre à avancer. Cela se fait naturellement, il y a une véritable harmonie entre nous.
Vous avez commencé votre carrière dans le 7e art par réaliser des documentaires et l’un d’entre eux en 2014 portait sur des prostituées. Comment vous est venue l’idée de ce documentaire sur ces femmes stigmatisées et le plus souvent hypocritement honnies ?
En ayant fait des études de journalisme, je me sentais très proche du documentaire, je ne voulais pas faire de la fiction, mais être réalisatrice de documentaire (c’est bien plus tard que j’ai rencontré la fiction et que j’en ai ressenti le besoin). Le premier documentaire que j’ai réalisé (sur la première Journée nationale de la femme marocaine) était une commande d’un ministère. L’idée était que je n’interviewe que des femmes qui avaient réussi professionnellement (comme celles qui sont devenues ministres, par exemple). Mais je ne voulais pas me cantonner à cette seule dimension. Ce que je souhaitais, c’était interroger des femmes jamais médiatisées et qui se battent tous les jours. Après avoir approché Aïcha Ech Chenna (militante de la cause des femmes), j’ai recherché le témoignage de jeunes mères célibataires qui gardaient leur enfant grâce à cette femme si courageuse. Il était essentiel pour moi que ces jeunes mères rejetées par la société puissent être entendues autant que celles qui ont fait une belle carrière. Contrairement à une information erronée qui circule sur la toile, mon second documentaire sur les prostituées n’a absolument pas servi de matrice à « Much Loved ». Nabyl Ayouch et moi avons une sensibilité assez proche.
C’est une coïncidence totale, il voulait réaliser un film sur la prostitution et moi en même temps je désirais faire un documentaire sur de vieilles prostituées. Chacun s’est lancé de son côté sur son travail en parallèle après je l’ai ensuite rejoint sur son film. Mon documentaire a bien été tourné cependant, il n’est jamais sorti. J’avais interviewé un grand nombre de femmes pour me focaliser au final sur quatre d’entre elles ; la plus âgée avait 95 ans. C’était un film très intimiste, je trouvais que ces femmes avaient un regard très vrai sur la société, très pur et puissant, elles luttaient avec dignité. Cela a été une période particulièrement enrichissante pour moi. Mon intention précise était d’explorer ce que vieillir veut dire en tant que prostituée, de décortiquer la relation au corps vieillissant avec ces questionnements : comment on vieillit quand on n’est plus désirable et « monnayable ? » Et comment on continue dans ce métier-là lorsque le corps commence à lâcher et que c’est la seule chose qui permet de vivre ? Cela m’a toujours intrigué de savoir comment on vieillit.
Ce qui m’intéressait également c’était la relation de ces femmes à la spiritualité et au sacré. Le métier qu’elles exercent est honni par la religion ; c’est un péché. Elles ont une relation très intime pas forcément à la religion, mais à la foi. Elles ne restent pas à la surface, dans les codes ou dans les rites. Ces femmes me disaient qu’après avoir eu des relations charnelles avec des hommes, elles prenaient le Coran dans leurs bras et s’endormaient ainsi. J’étais sûrement naïve à l’époque, je pensais que cela allait toucher les gens et peut être aidé à mieux les comprendre… Après « Much Loved » (avec le scandale et la folie autour de la sortie du film) je me suis rendu compte que c’était une vue de l’esprit et qu’elles seraient jugées d’une manière très sévère. Ce que je trouvais beau dans leur geste allait probablement être considéré comme blasphématoire. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas le sortir pour ne pas les mettre en danger. On avait beaucoup évoqué les risques qu’elles prenaient durant le tournage d’autant qu’elles se livraient à visage découvert. Certaines d’entre elles sont décédées depuis, mais d’autres vivent encore dans des quartiers populaires de Casablanca ou de Marrakech. Le documentaire débute d’ailleurs avec une femme qui avait 58 ans à l’époque et qui était en phase terminale d’un cancer. Elle était décharnée et désirait plus que tout témoigner tandis que sa famille tentait de s’y opposer. Elle hurlait qu’elle voulait être entendue, c’était d’une violence et d’une beauté incroyables. Elle est décédée peu de temps après.
Comme je le soulignais à l’instant, certaines de ces femmes sont toujours en vie, il y a leurs enfants, c’est délicat de le diffuser. Ce que ces femmes m’ont donné est très beau ; il y a d’autres manières de partager ça. Les personnes qui nous touchent, qui nous inspirent, restent et ce qui doit s’exprimer peut s’exprimer d’une autre façon, peut-être dans un autre film, à travers un roman. Je sais que leurs paroles trouveront un écho. Ce sont souvent des femmes exemplaires, je me rappelle particulièrement aussi de l’une d’elles qui avait exigé le respect chez elle avec ses enfants qu’elle avait élevés seule. Le père n’avait pas d’emploi, elle se prostituait et il faisait semblant de ne rien savoir. Elle travaillait pour tout le monde, se prostituant durant la journée afin de pouvoir s’occuper de ses enfants le soir. Et en grandissant plus tard, ces derniers ont voulu qu’elle cesse de boire de l’alcool et de fumer, ce qui était néanmoins son plaisir. Mais elle est parvenue à imposer sa liberté chez elle, ses garçons étaient beaucoup plus conservateurs qu’elle. C’était une femme magnifique, d’une puissance extraordinaire.
Dans « Adam », Samia, qui est une jeune femme et Alba n’utilisent pas de téléphone cellulaire ; il n’y pas d’écran de télévision dans le foyer et on est loin des réseaux sociaux. Les cuisines sont rustiques (peu d’électroménager). La situation est identique dans « Le Bleu du Caftan » autour des personnages principaux. Pourquoi ce choix d’avoir effacé toutes technologies alors qu’elles sont omniprésentes dans la société marocaine, quels que soient le milieu social et l’âge ?
Lorsque je rentre chez moi, je laisse mon téléphone devant la porte et je ne l’utilise pas. Toutes ces technologies deviennent écrasantes et prennent trop de place dans nos vies, elles sont tellement intrusives. Comme je m’en protège au quotidien, je n’ai aucune envie de les insérer dans mes films. À mon domicile, durant des années je n’allumais pas la télévision, elle était devenue un simple meuble. Dans « Adam » ou « Le Bleu du caftan » la télévision est là, mais elle est chez les voisins, elle est uniquement perceptible par le son. Par contre, il y a un poste de radio, je considère que sa présence est moins intrusive. Ce qui est bien au cinéma, c’est que l’on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer. J’aime également être dans un espace-temps qui n’est pas forcément défini parce que mes personnages dans mes films peuvent vivre à des périodes différentes.
Vous montrez dans vos films des familles que l’on n’a pas l’habitude de voir à l’écran ; mais qui sont pourtant des réalités sociologiques dans le Maroc contemporain. Dans « Adam », Alba est veuve, non remariée, elle élève seule sa fille (famille monoparentale) ; et dans « Le Bleu du Caftan », le couple formé par Halima et Mina n’a pas d’enfants.
C’est important, car on est souvent dans des schémas très classiques de ce qu’est la famille. C’est important de montrer d’autres réalités. J’ai passé beaucoup de temps dans les médinas et j’ai vu toutes sortes de familles différentes. Dans les deux films, ce sont surtout des individus qui ont opté pour vivre d’une certaine manière. Dans « Adam », Alba a choisi de ne pas se remarier, si elle l’avait fait elle serait rentrée dans les codes et dans la norme, mais elle fait le choix inverse et c’est ce qui explique que cela est difficile pour elle. Une femme veuve, célibataire, qui élève seule son enfant, c’est quelque chose qui apparaît comme suspicieux. Mais c’est une femme qui a du caractère, elle a décidé de se battre seule. Elle s’est fermée à la vie, elle n’éprouve pas le besoin de refaire sa vie avec un autre homme ; elle n’a jamais fait le deuil de son mari. Mais à partir de sa rencontre avec Samia, certaines choses vont changer dans son regard.
La mort, le deuil et ses rituels sont omniprésents dans vos films (déjà dans votre premier court, « Quand ils dorment », avec la mort du grand-père) ; dans « Adam », Alba est veuve et s’enferme dans son passé renonçant à vivre ; dans « Le Bleu du Caftan », Mina est emportée par son cancer et son corps est honoré d’une façon particulière, qui ne sera pas ici dévoilée. Dans « Razzia », Salima, que vous incarnez à l’écran, se rend sur la tombe de son père. Quel est votre rapport avec la finitude ?
C’est complexe. La mort a toujours été là dès ma plus tendre enfance. Quand j’ai perdu mon grand-père, j’avais huit ans, j’étais à ses côtés, ma mère également. Et c’est la première fois que je voyais quelqu’un partir. J’ai trouvé ce moment évidemment très douloureux et très beau également. Cela a réveillé en moi un rapport à la mort empreint de curiosité et de fascination. Mais jamais de peur, là où autour de moi je voyais justement de l’effroi lié à la mort. J’ai toujours ressenti quelque chose de très naturel dans la mort, de très beau et de très puissant, de très vrai. Déjà enfant, j’aimais les cimetières, aller sur les tombes, m’assoir sur les sépultures. Ma grand-mère était chrétienne et dans le cimetière où elle était inhumée, contrairement au cimetière musulman, je pouvais lire les épitaphes sur les pierres tombales. En fait, je suis devenue réalisatrice lorsque mon père est décédé. C’est à ce moment-là que j’ai éprouvé le besoin de réaliser mon premier court métrage, « Quand ils dorment ». C’est l’histoire d’une petite fille qui va dire au revoir à son grand-père comme elle le sent et non pas comme on l’impose à sa mère. Elle va prendre la liberté de le faire parce qu’elle est petite et innocente. À son âge, huit ans, elle ignore la pression sociale, elle n’est pas consciente de tout ça, elle est totalement libre. Elle agit selon ce que son cœur lui dicte et pas selon les contraintes posées par la société. Elle échappe à toutes ces normes-là.
Quand mon père a disparu, j’avais besoin de m’épancher ; j’ai écrit instinctivement un court métrage sous forme d’une fiction sans me dire que j’allais forcément en faire un film. Je ne pouvais pas raconter ce que je souhaitais exprimer dans un documentaire et je ne pensais pas non plus être vraiment outillée pour faire une fiction. Et c’est Nabyl qui m’a encouragée à la réalisation. Dans ce court métrage, la disparition et la séparation sont vraiment à l’origine du film ainsi que les rites autour de la mort. Dans « Adam », Alba est veuve et je ne savais pas pourquoi en fait, c’est une fois achevée l’écriture que je commence à déchiffrer le pourquoi de ce que j’ai rédigé. Je commence à apprendre des choses sur moi-même ; j’ai ainsi compris en fait pourquoi elle était demeurée veuve, elle est restée avec une profonde blessure (elle n’a pas pu faire le deuil de son époux, elle a été empêchée). Cette interrogation autour d’Alba s’est également prolongée dans « Le Bleu du caftan » avec Halim qui va pouvoir célébrer sa femme comme elle l’aurait souhaité. La mort a toujours été présente et je sais qu’elle va l’être. La finitude, c’est selon moi lorsque l’on prend conscience du fait que notre vie n’est pas éternelle et il y a des choses que l’on fait ainsi différemment. Dans « Le Bleu du caftan », Mina fait tout un voyage intérieur, car elle sait, elle a compris que sa fin était proche. Et je crois que cela peut être quelque chose de très beau et de très enrichissant que de se rendre compte que l’on arrive au terme de son existence. Cela peut nous rendre beaucoup plus fort ; cela peut nous donner une vraie sagesse de la vie.
Vous tournez essentiellement dans des décors naturels et dans un microcosme particulier, la médina. Effectuez-vous de nombreux repérages en amont ? Comment avez-vous arrêté votre choix pour Casablanca et Salé ? Avez-vous effectué des repérages dans d’autres médinas du royaume (Fès, Marrakech ou encore la Kasbah de Tanger) ?
Il y a tellement de médinas fascinantes au Maroc. À un moment donné, il faut aller là où il y a un lien, je fais référence à un lien émotionnel qui peut naître également d’une rencontre. C’est ce qui s’est passé d’ailleurs avec presque tous mes films. Pour moi, il était logique de tourner « Le Bleu du caftan » à Salé. Dans cette ville, j’ai eu un coup de cœur pour le cimetière où se termine le film. Ce lieu m’avait marqué quelques années auparavant lorsque je m’y étais rendue. J’avais l’agréable impression avec ce cimetière marin, ses tombes à perte de vue, d’avoir l’océan devant moi et un océan de tombes. Il émane de ce site quelque chose de magique : la matière avec laquelle sont conçues les sépultures (une terre jaunâtre), le reflet de la lumière sur les pierres tombales avec le soleil en fin de journée. J’ai conservé également le souvenir des mouettes sur les tombes, j’avais l’impression que ces oiseaux marins étaient sur chaque tombe et qu’ils contemplaient l’océan, comme une métaphore des âmes des défunts. Ceci m’a profondément émue, j’ai toujours gardé cette image en moi. J’y suis retournée plusieurs fois, j’aime d’ailleurs tout particulièrement déambuler dans les cimetières. J’ai toujours été fascinée par la mort et celle-ci trouve sa place dans tous mes films et ce n’est pas anodin.
La raison principale pour laquelle je suis revenue à Salé, c’est que j’avais vraiment besoin de ce cimetière. Mais Salé est également une ville qui est connue pour l’histoire de l’artisanat avec le travail des mâalems et encore aujourd’hui beaucoup d’entre eux y travaillent encore. Dans la Kasbah de Tanger, il y en a encore quelques-uns ; par contre à Casablanca, ils ne sont plus dans la médina, ils sont désormais à l’extérieur. A Salé, la mer est également très proche, on la sent, on l’entend, mais on ne la voit pas ; il y a un enfermement dans lequel je souhaitais mettre mes personnages qui vivent une claustration intérieure. J’avais envie d’aller vers cette ouverture à la fin du film. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais on ne voit pas le ciel, même lorsque l’on est à l’extérieur, les personnages évoluent entre les murs. Le ciel, on le découvre juste à la fin. Mon intérêt pour Salé tient également à ce que sa médina n’est pas faite pour les touristes, elle est authentique, elle vit. C’est d’ailleurs similaire pour la médina de Casablanca (dans sa partie basse, c’est-à-dire vers le port) où j’ai passé beaucoup de temps (pour « Aya va à la plage », pour mes documentaires). On ne retrouve pas cette authenticité dans les médinas plus touristiques.
Réécrivez-vous en cours de tournage ?
Très rarement, c’est très écrit. Je suis très à l’écoute de l’environnement dans lequel je tourne qui est souvent en milieu naturel et parfois il peut y avoir des surprises que j’ai envie d’intégrer.
Vos films évoluent-ils beaucoup au montage ?
Non, ils sont très écrits, ils sont très proches de l’écriture ; le montage est en général très fidèle à l’écriture.
Dans « Le Bleu du Caftan », il y a ce plan sur le sein mutilé de Mina » ; il est plutôt rare de montrer une poitrine de femme qui a subi une ablation au cinéma (il y a une scène dans « Aquarius » (2016) de Kleber Mendonça Filho avec le sein de Clara qui est incarnée par Sonia Braga). Par ailleurs, vous montrez aussi qu’en dépit de cette mutilation, la sensualité n’a pas disparu avec les caresses prodiguées par son mari. Dans « Adam », il y a également cette splendide et longue scène où Samia découvre peu à peu son bébé ; c’est un vibrant hommage à toutes les mères et ce n’est pas non plus si commun au cinéma.
Mon désir est de raconter l’intime en fait, de montrer l’intime par l’intime. Dans « Adam », les scènes avec le bébé ont exigé une longue préparation en amont. Dans l’une d’elles, Samia semble prête à étouffer le nourrisson, peut-être par désespoir et par amour, elle a peur de le laisser et de l’abandonner ; elle ne sait pas quoi faire. Puis il y a une bascule qui s’opère, elle se reprend. J’ai eu un témoignage d’une maman (qui était dans la situation de Samia) notamment qui avait tué son bébé, mais pas par manque d’amour justement, mais par ce qu’elle l’aimait ; c’est son avocat qui me l’a confié. Pour moi, c’est important de laisser vivre les scènes, et que les scènes prennent le temps qu’elles doivent prendre, que les personnages imposent leur rythme. Je n’aime pas lorsque l’on tourne que ce soit la course contre la montre. Or, sur un plateau de tournage, en général, c’est souvent ça. C’est très difficile pour moi de dire que je vais abandonner des scènes au montage, il y a parfois des scènes qui sautent. Mais j’aime quand je tourne pouvoir oublier le temps, la caméra est là pour capturer l’émotion et oublier ce qui se passe autour.
Dans vos deux courts métrages et dans « Adam », vous tournez avec des petites filles. Comment avez-vous obtenu des interprétations aussi naturelles de leur part ? Comment leur faire répéter les mêmes mots sans qu’elles perdent leur spontanéité ? Comment êtes-vous parvenue à lever leurs appréhensions devant la caméra ? Dans « Adam », étiez-vous aidée par un coach pour épauler Warda ?
Je suis enfant moi-même, je suis sérieuse en disant ça. Je me sens très petite fille au fond de moi. Je peux être adulte sur beaucoup de choses et très petite fille à l’intérieur, ce qui explique que j’ai toujours eu une vraie connexion avec les enfants. Déjà pour mon premier court, c’est vrai qu’il était peut-être risqué pour une première réalisation de fiction qui parle de la mort de tourner avec une petite fille de huit ans. Mais selon moi, elle pouvait comprendre ces choses-là ; je savais que l’on allait réussir ensemble. Je pense que les enfants ont une intelligence et une sensibilité incroyables et que les adultes ont beaucoup à apprendre d’eux. En prenant de l’âge, on se charge de tellement de choses, là où cela peut être tellement simple. Mon fils a maintenant six ans, à l’époque du court métrage je n’avais pas d’enfants, mais j’ai toujours eu une grande proximité avec eux. Il y a cette innocence qui les rend tellement libres, tellement purs et puissants. Il faut savoir parler aux enfants, nous perdons un côté de notre enfance en vieillissant. Mais je trouve que je ne l’ai pas perdu parce que je fais toujours des enfantillages moi-même. Sur « Adam », tout le monde me disait que tourner avec une petite fille qui n’avait aucune expérience devant l’œil de la caméra était une erreur, « tu vas gâcher ton film » me disait-on.
On m’avait présenté un grand nombre de petites filles qui avaient déjà tourné des publicités, mais je ne trouvais pas ma « Warda », car ces jeunes comédiennes étaient formatées, elles étaient très conscientes de leur image et voulaient agir d’une certaine manière. Je recherchais de la pureté, de la vérité. Nous étions à deux semaines du début du tournage et lors d’un repérage dans la médina, j’ai découvert une petite fille qui jouait ; on s’est regardées et je suis allée à sa rencontre. Je savais que c’était elle, j’ai obtenu l’accord de ses parents pour la revoir. Elle était très timide, quand je la filmais avec mon téléphone, elle ne parvenait même pas à me regarder. On a passé du temps ensemble. Toute sa timidité a fini par se volatiliser. Elle est extrêmement talentueuse, sensible et perspicace, elle comprenait tout ce que je lui expliquais, j’avais trouvé mon rayon de soleil.
La lumière prend une grande place dans vos deux œuvres ; elle semble coller aux émotions intérieures des personnages. Comment s’effectue votre collaboration avec Virginie Surdej qui a été la directrice de la photographie sur vos deux longs métrages et qui a d’ailleurs travaillé avec Nabyl Ayouch (« Much Loved », « Razzia », « Haut et fort ») ? Avez-vous des demandes ou des désirs précis sur les couleurs, sur la lumière ou laissez-vous la cheffe opératrice libre de vous faire des propositions ?
J’écris en son, en lumière, en couleurs. Je travaille beaucoup en amont sur les décors, sur les compositions de couleurs, les textures. J’aime la peinture, les peintres ; je suis très inspirée par Caravage, Vermeer, ce sont des inspirations intégrées. Virginie est une directrice de la photographie extraordinaire, très talentueuse ; c’est une femme d’une profonde sensibilité qui écoute beaucoup. Elle m’aide à raconter mes personnages comme je veux les raconter. Bien sûr, elle a une vraie force de proposition, elle est très perfectionniste. Il y a vraiment une excellente entente entre nous. Pour moi, la lumière a un sens, elle n’est pas là juste pour embellir, elle est là pour accompagner l’émotion, pour faire avancer un récit. Dans « Le Bleu du caftan », il était pour moi indispensable que la fin de vie de Mina s’effectue dans la lumière, qu’elle ne soit pas sombre. J’avais également envie que l’appartement du couple soit un petit havre de paix, je désirais que cette femme même affaiblie par la maladie devienne de plus en plus lumineuse, mais de plus en plus libre aussi.
Votre cinéma mise sur l’émotion tout en évinçant le pathos. Dans vos deux longs métrages, vous introduisez des séquences joyeuses, amicales, qui sont autant de moments de répit dans une atmosphère qui peut parfois être très pesante. Par exemple, dans « Le Bleu du caftan », il y a cette lumineuse chorégraphie improvisée entre Halim, Mina et Youssef, dernière étincelle de vivacité pour Mina qui est en fin de vie ; dans « Adam », il y a ce fou rire irrésistible entre les deux principaux protagonistes lorsque deux femmes dans la rue se chamaillent autour de la possession d’un mouton lors de l’Aïd.
Je n’ai pas dédramatisé de façon réfléchie. J’écris et après je me rends compte que j’avais besoin de ça. Concernant la scène du trio dans « Le Bleu du caftan », j’ai ressenti la nécessité de l’insérer. J’ai juste suivi mon instinct et je pense que la vie est faite de ça, il y a des moments tellement dramatiques, on passe également des larmes au rire. C’est tellement complexe et contradictoire, mais c’est juste la vie pour moi. Ça me fait du bien d’avoir ce petit exutoire ; ça ne part pas d’une réflexion.
Il ressort de vos diverses interviews et de votre cinéma que vous n’êtes pas une cinéaste porte-drapeau, mais peut-on soutenir que vous êtes une cinéaste engagée ? (dans « Razzia », vous incarnez Salima, une femme qui n’accepte pas que quiconque puisse lui dicter sa conduite et ainsi empiéter sa liberté. Au Maroc, mais également en Algérie, des jeunes femmes furent inquiétées pour avoir porté des jupes considérées par d’aucuns comme trop courtes[1]).
Engagée, oui j’imagine ; c’est d’ailleurs un terme que je trouve un peu difficile à définir. Je suis une cinéaste habitée par l’humain, il y a quelque chose qui me travaille intérieurement et qui est toujours en lien avec l’Autre. Je me suis rendu compte avec le recul que je vais naturellement vers des personnages qui ne trouvent pas nécessairement leurs places dans la société ; ils ne parviennent pas s’exprimer ouvertement et ne portent pas haut leur voix. J’aime porter cette voix, faire en sorte qu’ils existent, que leurs histoires aient leur place, car j’estime qu’elles sont importantes. Donc à ce niveau-là, on peut dire que c’est un cinéma engagé.
Qu’est-ce qui vous révolte le plus dans la société marocaine ?
Je ne pourrai pas faire de généralités. Il y a des choses qui me révoltent dans la société marocaine comme il y a des choses qui me révoltent dans d’autres sociétés. Ce qui me heurte profondément, c’est de voir des personnes qui ne peuvent pas vivre comme elles veulent, qui ne peuvent pas être qui elles sont. Mais ça, c’est chez nous comme ailleurs. Selon les contextes dans lesquels nous vivons, que ce soit au Maroc ou ailleurs, pour moi la liberté est la clef partout dans le monde ; la liberté de ressentir, d’exprimer.
Que pensez-vous du mouvement MeToo au Maroc ?
Il avait raison d’être, il a fait bouger les lignes par rapport à beaucoup de choses ; mais les dérives liées à ce mouvement peuvent être très néfastes. Le mouvement en soi est une démarche honorable que je valorise en même temps. Mais certaines choses discutables sont venues se greffer à ce mouvement là et à un moment, il y a eu un amalgame. Je pense que dans une société, il est important de pouvoir avancer ensemble et je sens maintenant que l’on oppose beaucoup trop les hommes et les femmes et ce n’est pas positif. Il y a de vraies questions avec des femmes qui continuent à se battre pour de vraies raisons, qui ont fait avancer des législations, mais aujourd’hui tout se mélange. Oui il y a un vrai féminisme et aussi un pseudo féminisme que je n’aime pas.
Commencer un premier rôle pour Ayoub Missioui dans « Le Bleu du caftan » en incarnant un personnage gay n’est-il pas difficile et délicat pour un acteur arabo-musulman ?
Oui cela aurait pu être très difficile. Lorsque j’ai rencontré Ayoub, j’ai été touchée surtout par sa passion, c’est un homme de 24 ans vraiment passionné, authentique et qui a beaucoup de dimensions. Il n’était pas comédien et il a tout abandonné pour faire du cinéma, car il a ressenti un appel intérieur très fort. Cette première impression m’a donné ensuite envie de revenir vers lui, un an après notre première rencontre. On a beaucoup parlé de ce que cela impliquait pour lui que d’interpréter un tel personnage ; je tenais à qu’il soit conscient de ce que cela voulait dire que de camper un tel rôle. On ne pouvait pas savoir comment le film allait être reçu lors de sa sortie et quelles seraient les réactions du public. Je voulais qu’il comprenne et aime son personnage et qu’il ait surtout envie de le défendre. Il a fait un vrai travail de connaissance des homosexuels, il est allé à la rencontre de quelque chose qu’il ne connaissait pas, il n’avait jamais eu d’amis gays avant le tournage du film. Il a pris le temps d’écouter, d’échanger et de comprendre. C’était important qu’il puisse interpréter son rôle avec le cœur. J’ai senti qu’il l’aimait. Il a été courageux d’incarner ce personnage. Et il continue dans le cinéma.
Comment « Le Bleu du Caftan » fut-il accueilli au Maroc par les spectateurs ? Odile Tremblay, critique au quotidien indépendant québécois Le Devoir, qui a assisté à la projection du film, lors de sa présentation au Festival International du film de Marrakech en novembre 2022 (où il décrocha le prix du jury) indique que « dans la salle, certains Marocains sortaient après des scènes homosexuelles, pourtant à peine esquissées. D’autres se sont levés pour applaudir le film à la fin de la projection »[2]. Par ailleurs, il y a eu un appel du PJD (parti islamiste) à l’interdiction du film. Ce qui a pu déplaire à d’aucuns ce sont peut-être pas seulement les scènes sexuelles qui ne sont pourtant que suggérées, mais le fait que Mina, qui est une femme très pieuse, a dépassé ses préceptes religieux et encourage son époux à être lui-même et ainsi à aimer l’homme dont il est éperdu.
Il y a eu un avant et un après-effet « Much Loved ». Beaucoup de Marocains ont pris conscience du fait que l’on n’avait pas à leur imposer de ne pas visionner un film ; cette liberté-là appartient à chacun. Aller au cinéma est un acte volontaire et il y a des personnes qui sont prêtes à voir le film et d’autres pas. C’est vrai que « Le Bleu du caftan » pose des questions qui ne sont pas ouvertement débattues dans la société. Mais pour moi le plus important, c’est que le film ait eu un distributeur, qu’il ait été projeté en salles, que les personnages du film aient pu exister ouvertement à un moment donné sur les écrans marocains. J’ai entendu des témoignages très touchants de personnes qui firent le choix d’aller voir le film en famille. Il y a selon moi un désir de plus en plus fort de pouvoir discuter autour de ces sujets sensibles (que l’on considère comme tabous) de la part des jeunes et également de personnes plus âgées.
Vous êtes réalisatrice, mais également actrice (un seul rôle jusqu’à présent derrière la caméra de Nabyl Ayouch où vous campez Salima dans « Razzia). Est-ce que le jeu vous manque lorsque vous réalisez ? Recevez-vous des propositions de cinéastes et avec quels réalisateurs ou réalisatrices aspirez-vous de tourner ?
Honnêtement je ne rêve pas de tourner avec un cinéaste en particulier. Je reçois des propositions, mais je n’ai jamais reçu quelque chose qui m’a vraiment pris par les tripes. J’ai besoin de sentir que les choses que je fais ont un sens. Oui j’aimerais pouvoir jouer, mais je ne veux pas jouer pour jouer. Mais j’aime pouvoir incarner des personnages, exprimer des émotions autrement. J’ai participé à l’écriture du personnage de Salima, mais je n’étais pas censée jouer dans ce film. Nous n’avons jamais écrit en se disant que c’était un personnage pour moi. C’est lorsque nous avons achevé l’écriture avec Nabyl qu’il m’a demandé de passer des essais pour le rôle. Au début, j’avais des doutes, ce n’est simple de jouer pour son époux, je craignais de gâcher son film, de le décevoir et de ne pas être à la hauteur. Les essais se sont avérés concluants pour Nabyl ainsi que pour les producteurs. Mais en même temps, je savais que Nabyl est quelqu’un qui a beaucoup de foi en ce qu’il fait sinon il ne le fait pas ; il y croyait complètement sans quoi il n’aurait pas donné suite. Pour mon premier long métrage, cela m’a sûrement apporté une expérience dans le travail avec les comédiens, savoir ce que c’est que d’être de l’autre côté de la caméra.
Vous avez été critique de cinéma au Maroc après la fin de vos études à Londres. Dans les films en provenance du Maghreb ou de la rive sud de la Méditerranée, le regard porté par la critique a tendance à s’appesantir sur leur dimension anthropologique et de bien moins s’interroger sur la construction filmique, sur l’esthétisme de l’œuvre.
Il faut se délester de ça et voir les films pour ce qu’ils sont et non en prenant en compte ce genre de considération là ; je trouve cela beaucoup trop réducteur.
En dépit de votre investissement dans le 7e art, vous trouvez encore le temps de peindre pendant votre temps libre ?
Ces derniers temps non. Mais cela me manque beaucoup. J’aspire beaucoup à retrouver ce temps-là.
Votre prochain projet cinématographique ?
C’est en gestation, j’ai beaucoup de mal à en parler tant que je n’ai pas laissé tout sortir.
Ce sera un scénario original ou l’adaptation d’un roman ou d’une nouvelle ?
Non, ce sera à nouveau une création originale.
[1] En 2015, deux jeunes femmes de 23 et 29 ans avaient été poursuivies devant le tribunal d’instance d’Inezgane pour attentat à la pudeur (leurs jupes étaient trop courtes) ; elles risquaient jusqu’à deux ans de prison ferme. Finalement, le ministère public a demandé le retrait des poursuites.
[2] Odile Tremblay, « Sarrentino à la Mamounia » hhttps://www.ledevoir.com/ 16 novembre 2022.