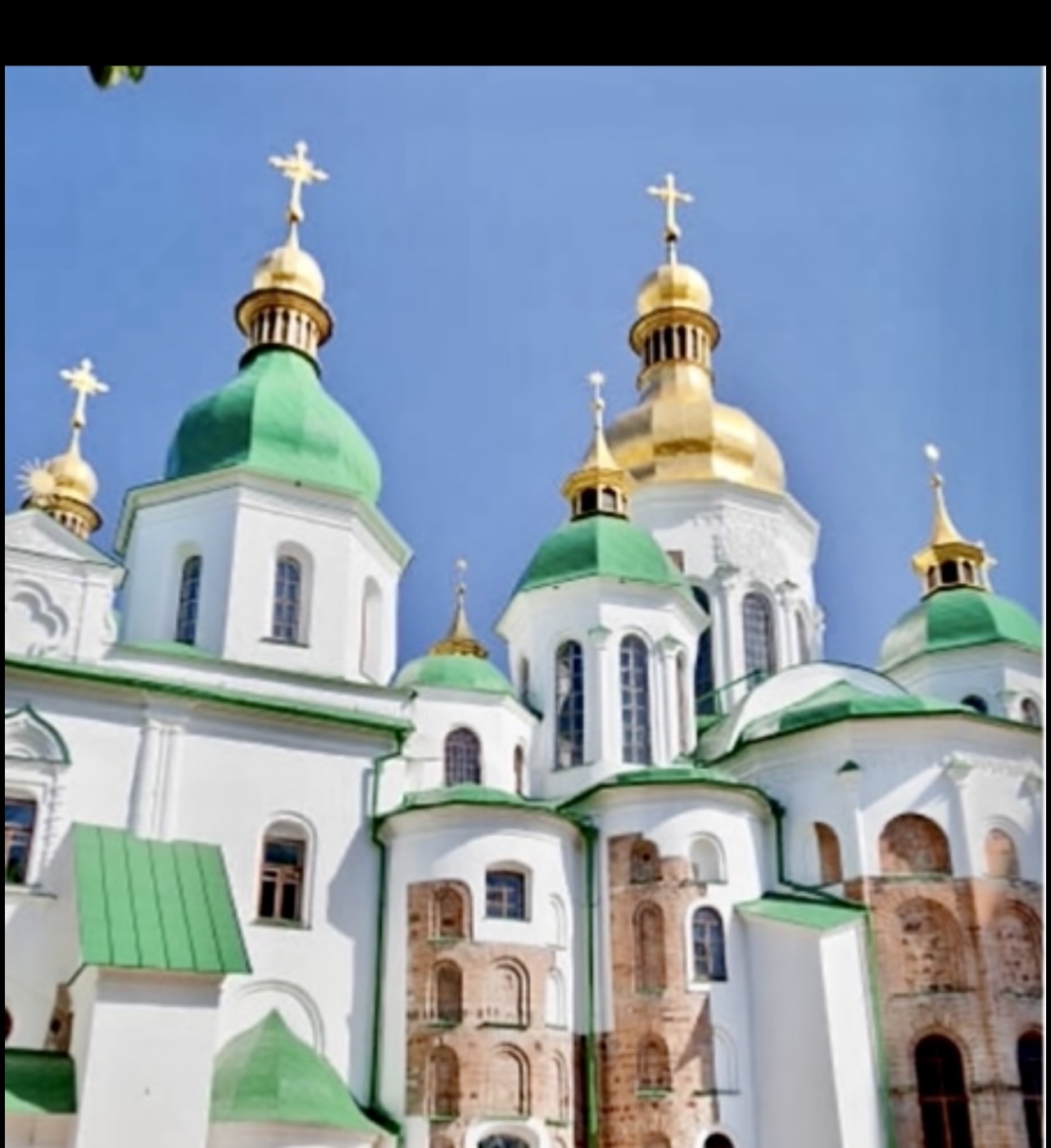
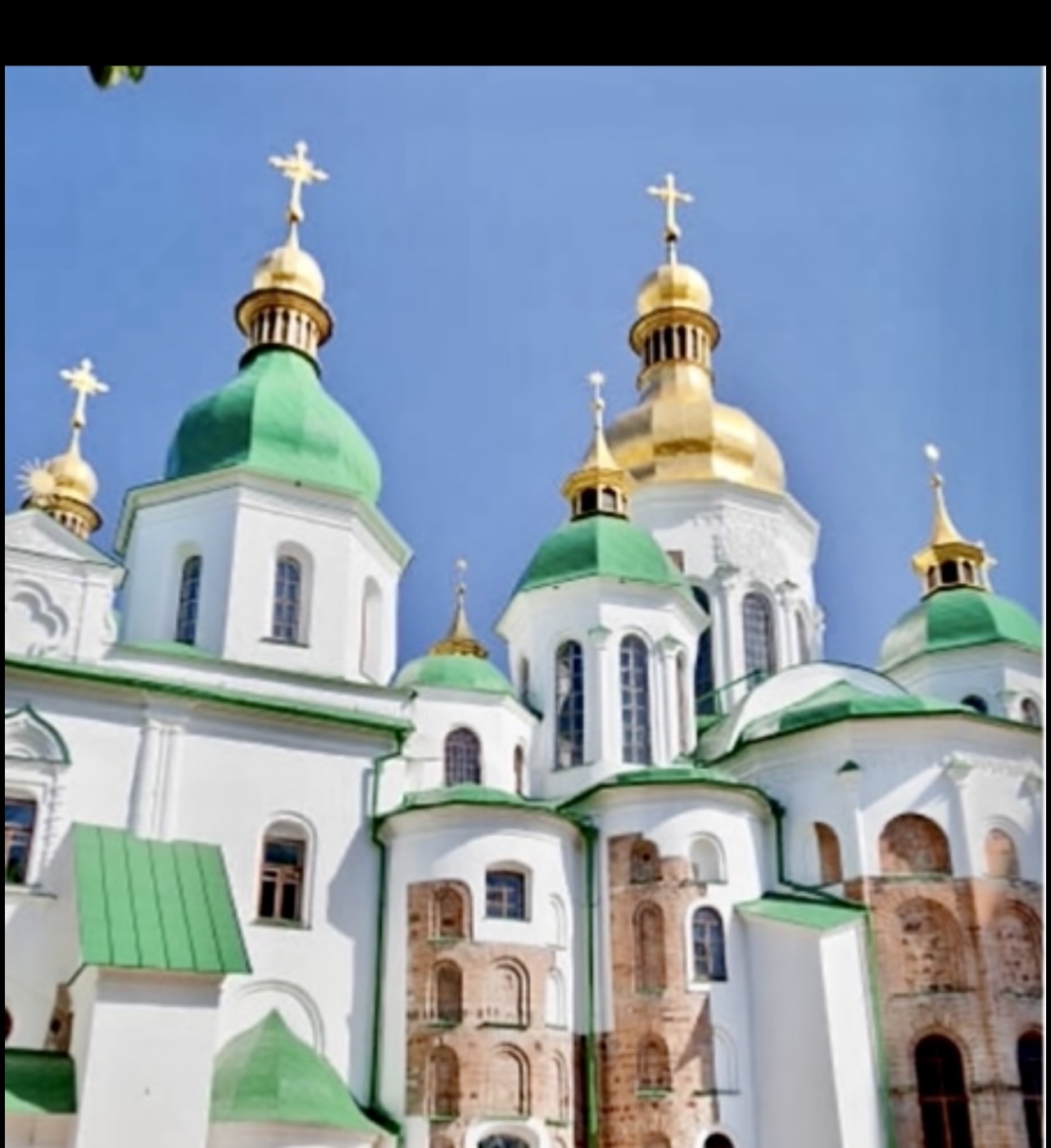
Docteur en philosophie. Il a enseigné dans plusieurs universités et cégeps du Québec. En plus d’être conférencier, il a notamment publié un ouvrage sur la pensée de Nicolas Berdiaeff, un essai intitulé « Pour une philosophie spirituelle occidentale », ainsi que deux ouvrages didactiques.