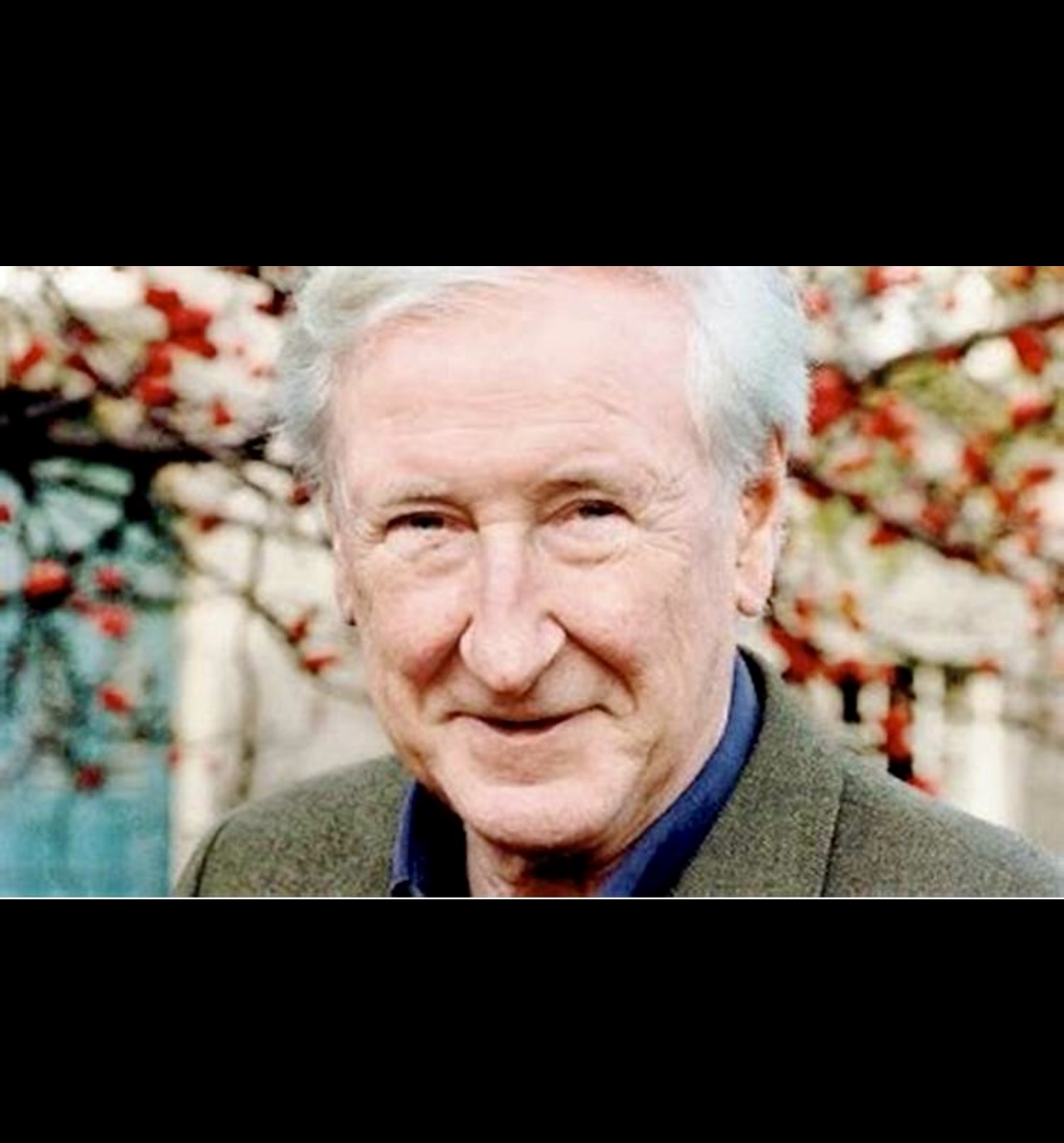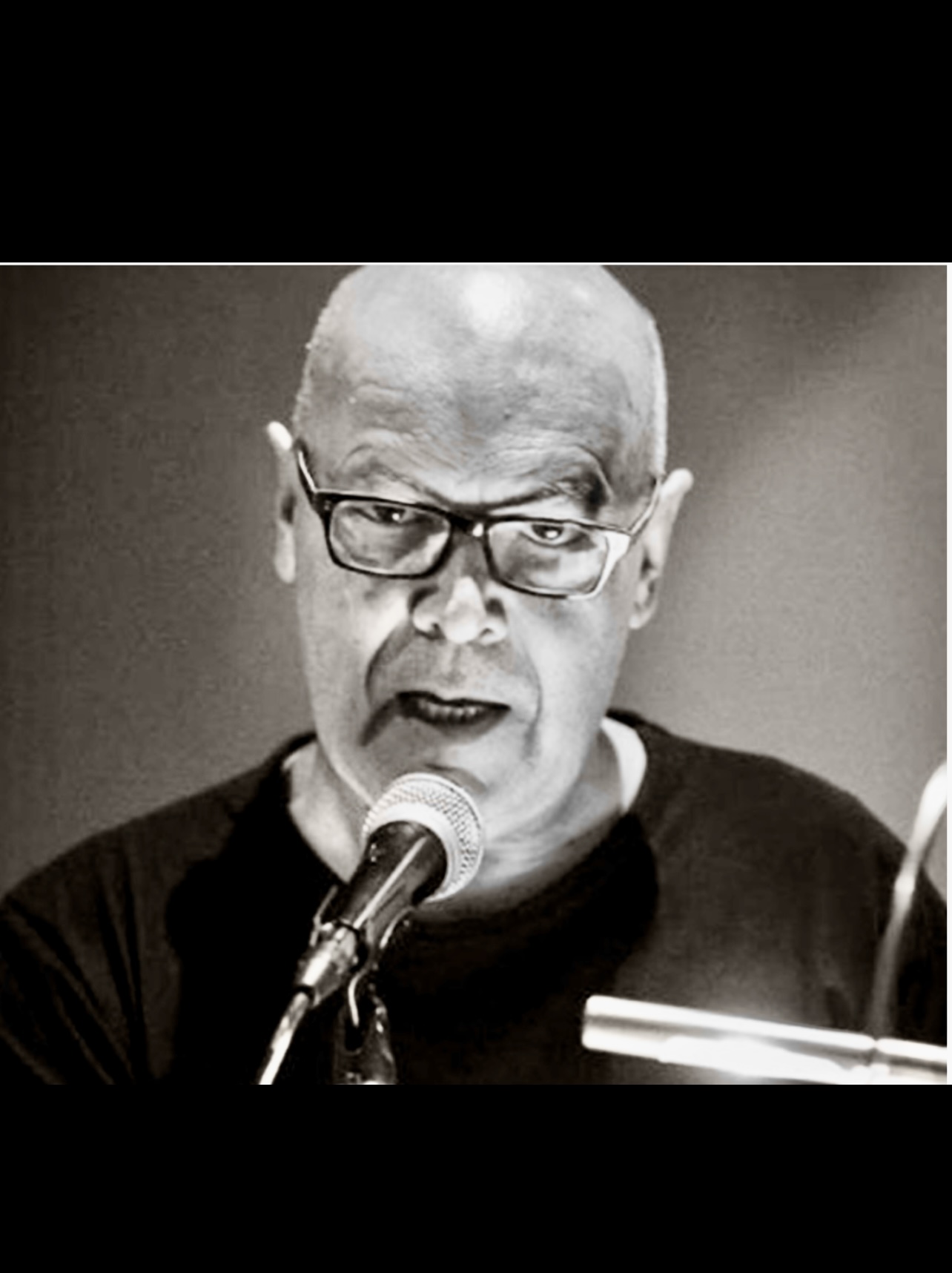Sophie et ses hommes. Par Marie Desjardins
Il y a cent cinquante ans, en février 1874, la comtesse de Ségur s’éteignait à Paris.
Qui était donc l’auteur des Malheurs de Sophie, des Mémoires d’un âne, de Pauvre Blaise? La comtesse de Ségur est de plus en plus difficile à cerner, sous le poids de ses étiquettes – autant de lieux communs : fille d’un incendiaire, Russe roulant ses r, aristocrate sadomasochiste, grand-mère écrivain à l’eau de rose, grenouille de bénitier, perverse.
Et quoi encore?
Une femme, par exemple.
Sophie de Ségur, née Rostopchine, se mit à l’écriture à l’âge où elle affirmait vouloir mourir, estimant avoir fait le tour de la vie. Ses intentions littéraires étaient spontanées : faire plaisir à Camille et Madeleine de Malaret, ses petites-filles (modèles) qui, installées à Londres auprès de leur père diplomate, se languissaient de ses histoires. Sophie était impulsive, généreuse et efficace. Après s’être fait la main en quelques jours avec ses Nouveaux Contes de Fées, elle revint à la charge et créa sans s’en rendre compte le roman psychologique pour enfants. Vingt livres en treize ans de travail firent de cette Russe en exil la figure féminine la plus percutante de la littérature enfantine du 19e siècle et bien après.
On souligne rarement que Sophie de Ségur était une contemporaine de George Sand, de Marie d’Agoult, d’Adèle Hugo, des héroïnes de Balzac, Musset et Nerval. On l’imagine mal frémissant sous le corps d’un homme, ou après celui qui lui faisait faux bond quatre jours sur sept : son mari. Sa statue que l’on peut toujours admirer au jardin du Luxembourg n’inspire pas ces évocations sensuelles, pas plus que les photographies qui ont transmis l’air sévère qu’elle avait à soixante-dix ans, alors usée par sa complexe existence, ses enfants, ses hommes…
Pour retrouver la Sophie Rostopchine aux yeux gris, à la carnation veloutée, à la bouche prête à rire, au tempérament fougueux, il faut se rendreau Musée Carnavalet et admirer certaine aquarelle qui nous la montre à vingt-trois ans, jolie et délicieusement moqueuse. Un demi-siècle plus tard, cette charmante personne mit au monde l’inoubliable Sophie des Malheurs, petite écorchée délinquante criant son désir d’être et réclamant son droit d’exister avant que la mort vienne, puisqu’elle vient toujours trop vite même quand on la réclame, comme la comtesse le fit pendant les quatorze jours que dura son agonie.
Cette passionnée n’eut pas une douzaine d’amants pour la rendre aussi intéressante qu’Aurore Dupin dans la petite histoire des mœurs et des amours. C’est que Sophie exécrait les intrigues et surtout la vanité des sottes qu’elle se devait de fréquenter dans son quartier du Faubourg Saint-Germain. Du reste, ce ne furent pas les hommes qui manquèrent dans sa vie. On se demande même comment elle réussit à donner de la tête parmi tous ceux qui marquèrent son destin. Trois fois au moins, Sophie passa à un cheveu de ne jamais devenir comtesse de Ségur. Si son père y avait consenti, elle aurait épousé Rodolphe de Maistre, le neveu de Joseph, qui fut long à se consoler de ne pas avoir obtenu la main de cette jeune fille de quinze ans dont il était très amoureux. Sophie flirta ensuite innocemment avec un Danois lors d’une balade dans la campagne de Saint-Pétersbourg. Toutefois, son idylle enflammée avec le comte Michel, rencontré en Allemagne, demeure plus mystérieuse. Si Sophie, dix-sept ans, avait été d’un autre temps, elle ne se serait pas fait prier pour se donner à lui.
Cependant le premier homme de sa vie, et de loin le plus important, fut son père. Le comte Fiodor Rostopchine lui paraissait tout-puissant et elle lui voua, sa vie durant, une admiration sans bornes. Elle le trouvait beau, intelligent, drôle, spirituel, et vibrait à sa profonde sensibilité. À l’instar de sa sœur Nathalie, Sophie en voulait à sa mère, Catherine Protassov, de le bouleverser avec ses hérésies (orthodoxe devenue athée, Catherine se convertit au catholicisme et traumatisa les siens par son austérité). Dès l’âge de quatre ans, pour compenser, Sophie assuma le rôle de bouffon de la famille. Elle racontait « des historiettes auxquelles personne ne compre[nait] rien » mais qui faisaient rire Fiodor aux éclats. Sophie n’était heureuse que si son père l’était. Or ce dernier, ministre du tsar Paul 1er, tour à tour encensé et répudié, sombra dans la dépression lorsque le tsar, par ailleurs parrain de Sophie, fut assassiné. Les choses s’aggravèrent avec le début des campagnes napoléoniennes et surtout en 1812, quand Alexandre 1er, fils de Paul, le nomma gouverneur de Moscou. Rostopchine se donna à fond à cette tâche qu’il accepta à contrecœur. Il contribua à mettre le feu à la ville, parvenant ainsi à faire reculer les troupes de Napoléon et récolta, en guise de récompense, le mépris de nombreux Moscovites qui retrouvèrent leurs maisons en cendres. Cependant, aux yeux de Sophie, Fiodor était un héros ayant débarrassé le pays de l’envahisseur et elle fut au désespoir de provoquer sa colère et de perdre momentanément son affection lorsque, forcée par sa mère, elle abjura la religion orthodoxe pour se faire catholique.
Tout cela s’effaça, heureusement, lorsque la famille se retrouva en France en 1817, auprès de Fiodor qui s’y était installé pour se refaire une santé mentale et physique. L’ex-gouverneur, en partie responsable de la chute de Napoléon et par conséquent de la paix en Europe, était reçu partout à Paris. Sophie découvrit en lui un magicien, un homme convoité par les femmes, un père heureux. Il traîna ses filles dans la capitale, au théâtre, dans les jardins, chez les gens, et les couvrit de cadeaux. Lorsque Sophie se plaignit, deux ans plus tard, de l’exiguïté des appartements qu’elle partageait avec Eugène de Ségur (à qui on la maria puisqu’elle était catholique), Fiodor lui offrit le château des Nouettes, en Normandie. Une largesse de père fatale pour Eugène dont la position fut à jamais compromise dans l’inconscient de Sophie.
Au demeurant, elle n’était pas sans se languir de ce mari (surtout au début). « Voilà trois jours que tu es parti, et il me semble qu’il y a des siècles », lui écrivait-elle, le corps en feu de ce qu’il lui avait appris dans l’intimité de leur alcôve. Eugène vaquait à ses tâches et surtout à ses affaires de cœur. Il était sensible au charme de Sophie, mais pas assez épris de l’exotisme de ses origines et des fluctuations de son caractère pour se passer des femmes qui savaient mieux le caresser que cette tigresse timide. Il la désirait sans la respecter vraiment, et l’aimait sans l’écouter. À la naissance de son premier enfant, la tigresse se transforma en lionne : Sophie se consacra à Gaston.
Rue de Varenne, elle était souvent accablée par sa condition de femme au foyer, d’autant qu’y était incrustée sa pesante sa belle-mère, une autoritaire qui faisait faire à Eugène ce qu’elle voulait. Les fréquentes visites des siens la consolaient, mais elle angoissait à l’idée de leur retour en Russie, aussi imminent que définitif. Elle serait alors véritablement seule, déracinée, acculée à sa marginalité et aux prises avec les Ségur qui ne cesseraient de la harceler de n’avoir pas apporté, à cause d’une douteuse histoire de banquiers, la dot qu’ils avaient convoitée au moment de lui sacrifier Eugène. Quand Fiodor repartit enfin avec sa famille, Sophie souffrit cruellement de perdre un ami, l’homme à qui elle n’avait pas besoin de se confier pour être entendue, celui qui l’aima sans une ombre d’égoïsme, le seul qui ne la déçut jamais. Elle se referma sur son passé, n’enseigna jamais un mot de russe à ses enfants et pleura sur les lettres infiniment tristes que Fiodor lui envoyait de Russie, jusqu’à qu’elle le sache à jamais sous une dalle dans le parc familial – à jamais vivant dans son cœur.
On a maintes fois rapporté que « le bel Eugène » était un coureur de jupons. Cet amateur de frivolités était en vérité aussi sévère que léger, et il veilla à ce que ses enfants n’aient pas à pâtir de la trop grande indulgence de leur mère. On se méfiait, chez les Ségur, de la slave qu’était Sophie, de son côté mélancolique, secret, et de sa tendance à envelopper ses enfants d’une tendresse exagérée. À l’arrachement aux siens, s’ajouta par conséquent celui auquel l’obligea Eugène : il mit le petit Gaston en pension à Fontenay-aux-Roses. Quand le dimanche arrivait, et que Gaston revenait à Paris, Sophie passait sa journée dans un fauteuil avec lui. Ils se regardaient, se câlinaient et se mettaient à pleurer lorsque le garçon disait : « Plus que tant d’heures à passer avec vous, maman. » Lorsqu’Eugène sonnait le glas de la visite, Sophie éclatait en sanglots, Gaston se cramponnait à elle, la belle-mère levait les yeux au ciel, la scène était désolante.
Pour moins souffrir de l’exil et de ses difficultés conjugales, Sophie s’était surtout tournée vers ce fils profondément sensible. Dans les yeux de cet enfant, il y avait la vraie lumière de l’amour, totale, celle-là même que Sophie avait vue dans ceux de Fiodor. Rien à voir avec la furtive fascination, le désir ou même la tendresse qu’elle lisait dans ceux d’Eugène. Gaston savait la comprendre, voulait son bien, déplorait de la sentir agitée, malheureuse, trompée, et il dut apprendre à ne pas en vouloir à son père.
Plus d’une énigme dans l’histoire des hommes de Sophie. Celle des frères, par exemple. L’un, Paul, meurt en 1801 selon certaines sources (Sophie avait alors deux ans) ou en 1810, selon d’autres. Si cette date était la bonne, alors le mystère des Malheurs de Sophie serait résolu : le personnage de Paul, cousin malmené mais bien-aimé de la petite Sophie, perdu lors d’un naufrage et miraculeusement retrouvé dans Les Vacances, serait ce frère disparu trop tôt.
Deux autres frères, vivants ceux-là : André, né quatorze ans après elle, lui permit de se familiariser avec l’art d’être mère avant de le devenir. Quant à Serge, l’aîné, il fut le plus romantique des Rostopchine. Asthmatique, tourmenté par sa mère, il fit le malheur de son père en se ruinant au jeu et le bonheur de sa sœur Sophie en lui confiant l’enfant qu’il eut d’une maîtresse italienne. Sophie recueillit le « bâtard » en France, en fit le frère de ses enfants, le compagnon de jeu de sa fille Olga et son fils bien-aimé. Elle couva Voldemar, ce petit bout de Russie venu jusqu’à elle comme un cadeau du ciel, et le défendit avec férocité lorsqu’il fut temps de faire reconnaître ses origines paternelles. L’enfant vénéra sa tante et se manifesta toujours sans qu’elle ait besoin de l’appeler. Le lien qui les unissait – ce rôle que Sophie joua pour lui en devenant la femme de son frère pour devenir sa mère – demeure aussi délicat à analyser que le fait que Gaston ait fait de l’Église l’unique rivale de sa mère. Car on peut qualifier d’incestueuses ces unions physiquement correctes.
Lorsque Gaston, en effet, annonça à sa famille sa décision d’entrer en religion, Sophie crut ne pas se relever de la dépression qui l’atterra. Au bout de cinq ans, après avoir vainement lutté à convaincre son fils de renoncer à cette voie, elle se prosterna à ses pieds et reçut de lui la communion. Dès lors, elle déploya tout ce que son cœur contenait d’amour pour le soutenir, l’accompagnant dans ses missions, soumettant à sa critique chacun de ses manuscrits et embrassant ses convictions jusqu’à entrer dans le tiers-ordre franciscain. Quand Gaston devint aveugle, Sophie redoubla d’attentions à l’égard de ce fils que nulle femme, autre que l’Église, ne lui ravit. Prêtre, Gaston resta fidèle à sa mère; il devint son allié, son collaborateur, son guide spirituel. Il fut le véritable homme de sa vie, au quotidien, mais il était loin d’être le seul à graviter autour d’elle.
Quand il devint auditeur de la Rota, Sophie séjourna à Rome pendant plusieurs mois. Cette mère de huit enfants avait alors plus de cinquante ans, et c’est dans la ville sainte qu’elle fit la connaissance du journaliste Louis Veuillot, qui avait quinze ans de moins qu’elle. Ce fut un coup de foudre amical et intellectuel. De retour en France, Sophie l’invita souvent aux Nouettes avec sa famille. Le fondateur de L’Univers venait y séjourner pour écrire et se ressourcer à même l’affection de celle qu’il appelait « maman Ségur ».Sophie l’adorait. Rien n’était trop beau pour lui : elle le faisait manger comme un ogre, multipliait les idées de promenade, traduisait pour lui des textes russes, et si Veuillot refusait ses invitations, prétextant que toutes ces gâteries l’empêchaient de travailler, elle lui expédiait des terrines, des poulets et des lettres d’encouragement. Il y avait entre eux, outre une très profonde amitié, de l’admiration, une attraction certaine, quelque chose d’assez fort pour qu’à Paris, Sophie le convie à déjeuner tous les jours où elle savait qu’Eugène ne rentrerait pas, car son mari ne pouvait supporter ce pamphlétaire emporté. Sophie avait besoin de la présence de Veuillot. Avec lui elle pouvait parler littérature, métier. Elle lui devait d’avoir reconnu l’écrivain latent en elle et qu’elle devint spectaculairement à la suite de cette révélation.
La plupart du temps, Eugène de Ségur séjournait dans la famille de son frère. Aux Nouettes, Sophie passait pour une femme seule. Cependant elle était entourée, d’hommes en particulier. Outre les domestiques, les gens de la ferme, le médecin, le curé, les connaissances, il y avait ses enfants et leurs amis. Avec eux, elle jouait au whist, au billard, à cache-cache, à colin-maillard et bien souvent, elle gagnait. Elle était toujours belle, se jetait sur un divan pour rire à son aise, courait plus vite que ses filles. Parmi les jeunes hommes qui traînaient chez elle, certains rêvaient d’elle en secret. Charles Gounod, par exemple, qui composa aux Nouettes à cette époque, ne cacha pas sa fascination pour son tempérament impétueux. Il disait de Sophie «qu’elle en valait dix».
Au moment où ses filles se marièrent, Sophie dut faire place à ses gendres dans la galerie de ses hommes. Elle n’aima pas beaucoup Paul de Malaret, l’époux de Nathalie, le père des petites filles modèles. Il fumait, s’adonnait à des activités aussi « stupides » que la chasse à courre et avait installé les siens à Londres, ville qu’elle détesta, surtout à cause de lui. Sophie préféra Armand Fresneau, mari de sa fille Henriette, qui lui fit découvrir les beautés de son Morbihan natal. Ce fut du reste à Émile de Pitray, époux d’Olga, à qui elle voua un véritable culte, lui écrivant des tonnes de lettres dans lesquelles elle l’encensait. Cela ne n’empêcha pas d’écrire un jour « À bas les maris! », qui ne lui paraissaient n’avoir pour fonction que gâcher la vie des femmes.
Dans son œuvre, Sophie régla tout. Ses vingt romans permettent de découvrir la nature de ses relations avec les hommes, la connaissance profonde qu’elle en avait, et l’homme idéal dont elle ne cessa de brosser le portrait malgré ses propres déconvenues. Tous sont à relire, car à bien des égards ils n’ont pas vieilli et révèlent à qui sait lire en filigrane l’étonnante femme que fut cette étrangère devenue un écrivain français, dont la fascination continue de se perpétuer.


Lire aussi : Les yeux de la comtesse. (Sophie de Ségur, née Rostopchine). Marie Desjardins et Marc Hébert, Humanitas, 1998, 119 p.
&&&
Les éditeurs de la Métropole & de la Capitale (ÉMC) sont fiers d’annoncer la parution d’un excellent livre de recettes magnifiquement illustré : Inspiré par Solange. Pour commander : Les éditions du Mont Royal.